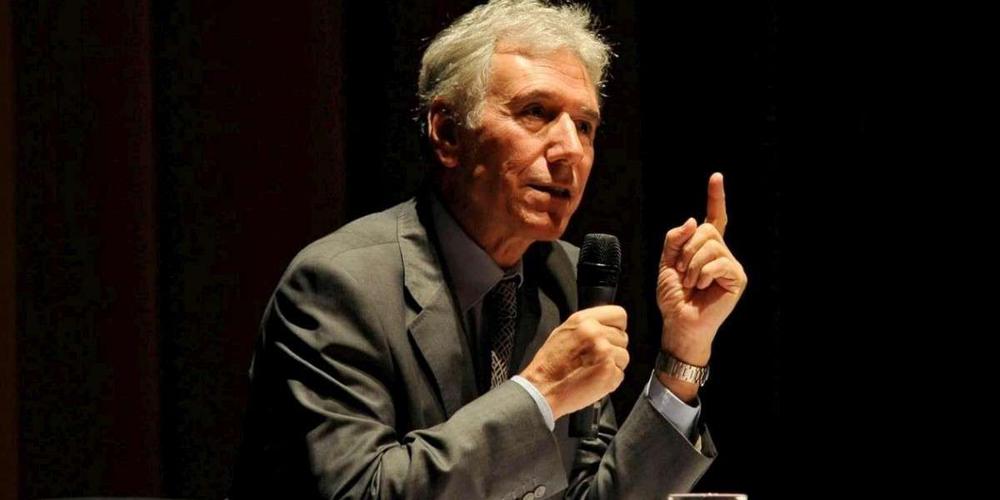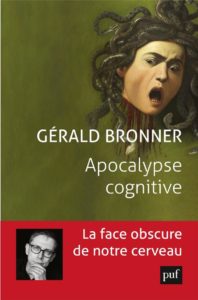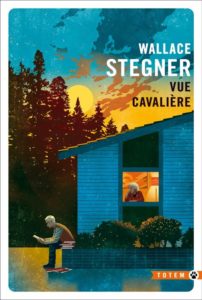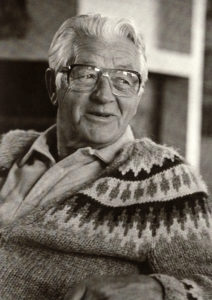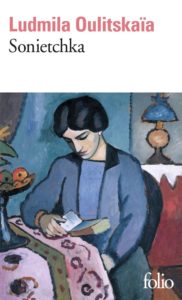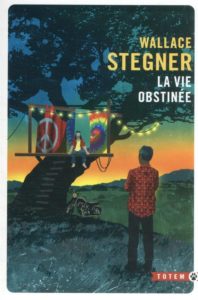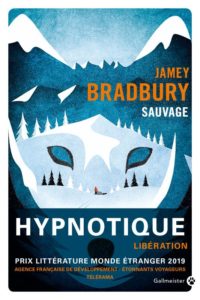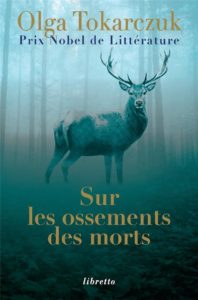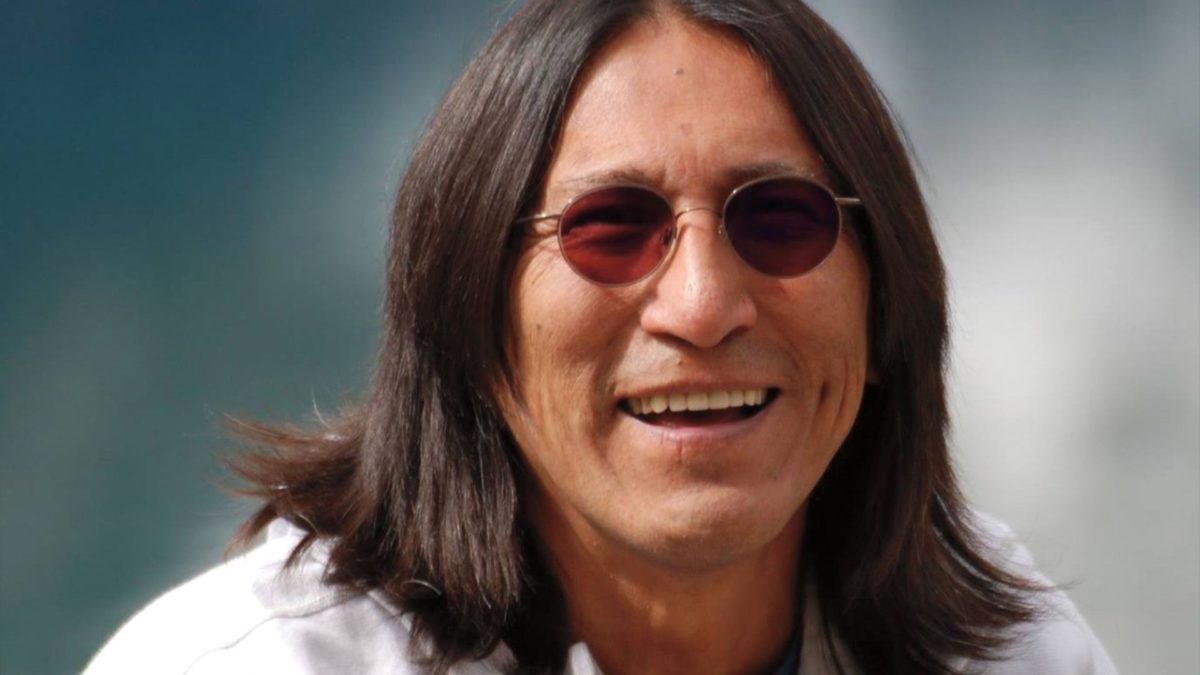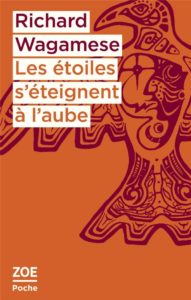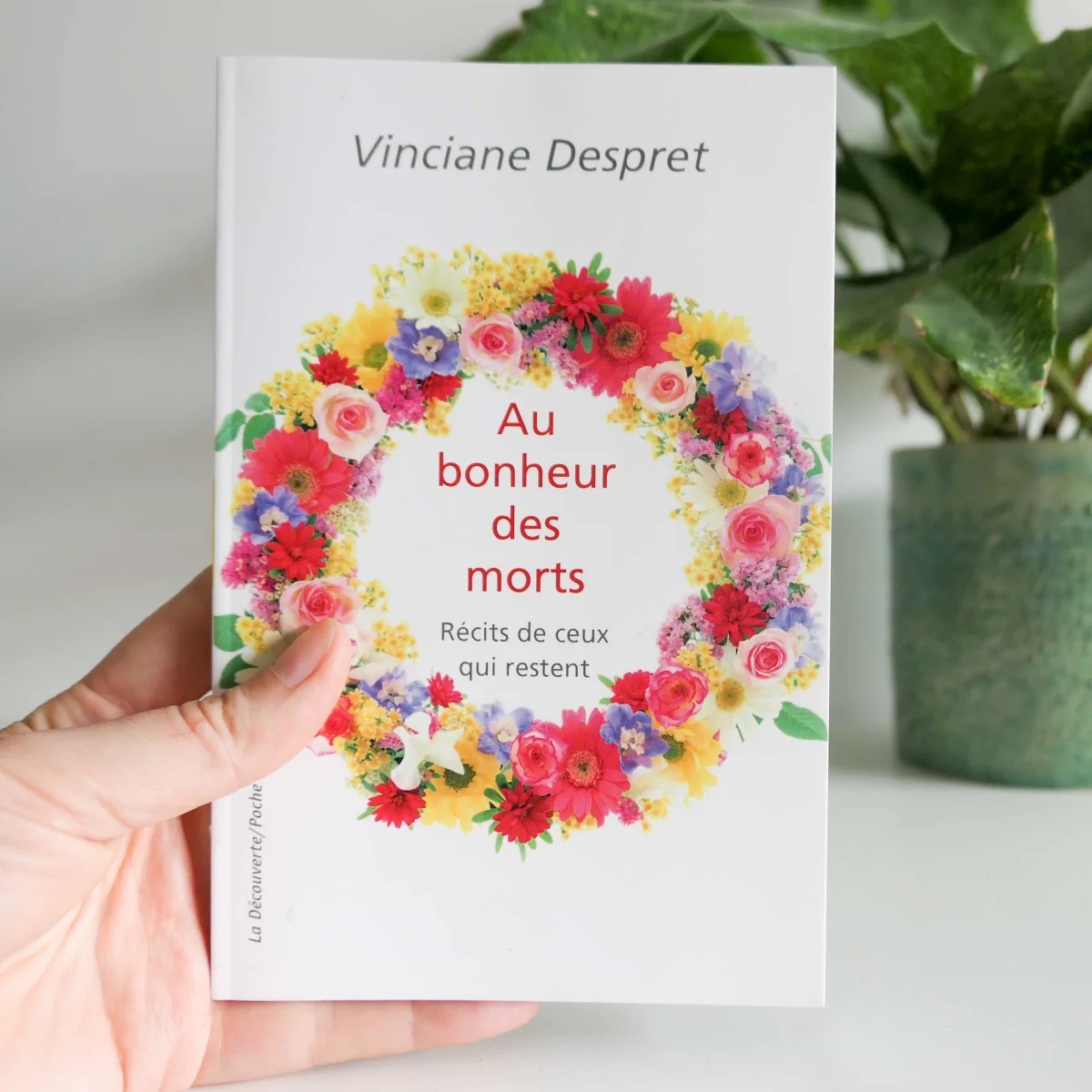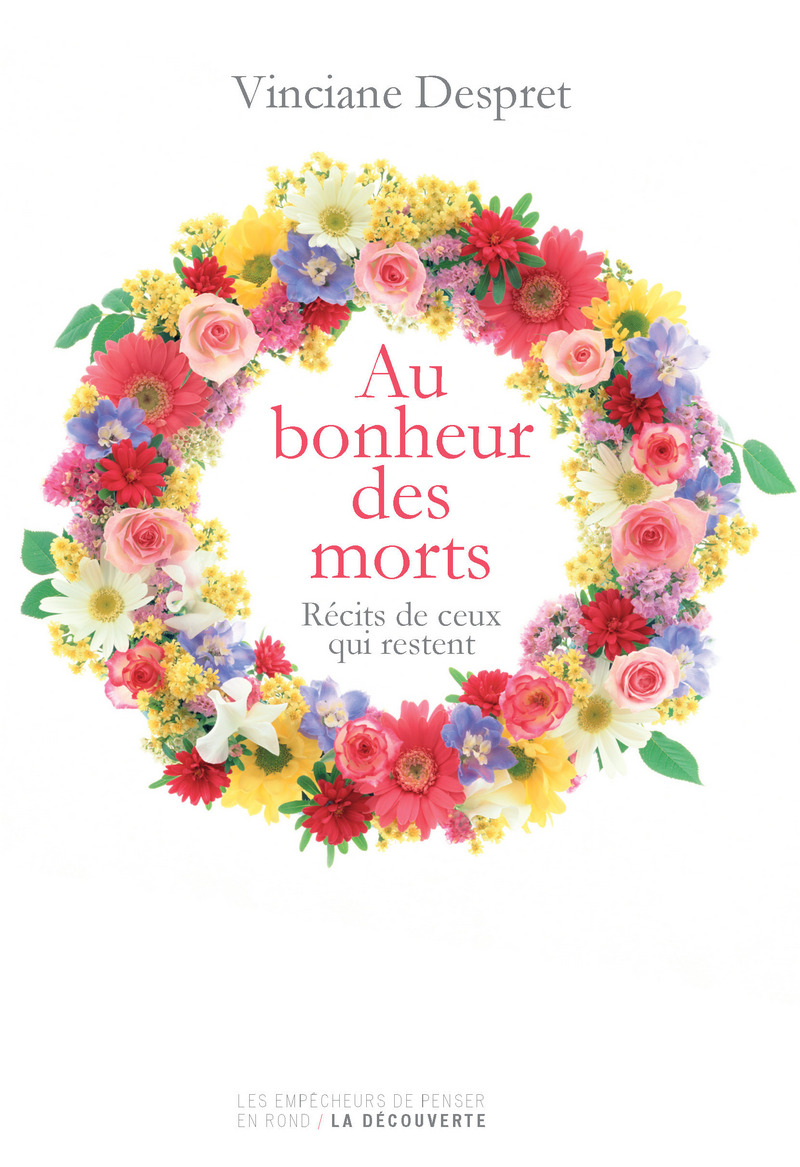Ce qu’ils en disent…
[LIBREL.BE] Le nez de Cléopâtre qui a changé le monde, le feu de Prométhée, la chute d’Icare… Ces mythes et histoires sont à l’origine même de notre civilisation. Peut-on mieux définir l’amour-passion qu’en évoquant Tristan et Yseut ? ou l’aveuglement par l’histoire si connue d’oedipe ? Henri Pena-Ruiz nous invite, comme dans une conversation entre amis, à réfléchir sur les conquêtes de la culture et de la technologie, le bonheur illusoire ou la paralysie de l’indifférence.
Il n’est pas si difficile de penser la vie et le monde. Ni les grandes questions qui nous tourmentent. Venus du fond des âges, des images et des récits nous y aident. L’amour passion de Tristan et Yseut, l’envol de l’homme-oiseau Icare, le déluge qui submerge l’ancien monde, l’aveuglement d’Oedipe qui réalise son destin en voulant le fuir, l’hésitation de César avant de franchir le Rubicon, le nez de Cléopâtre, maîtresse de l’empereur de Rome… L’idée de réunir ce patrimoine d’images et de récits qui parlent à l’imagination et guident la pensée avait inspiré un premier livre, le Roman du monde. Le succès de cet ouvrage a conduit à la série d’émissions de radio proposée par France-Culture durant l’été 2005, Grandes Légendes de la pensée. Le genre retenu pour ces émissions devait conduire à son tour à un nouveau livre, plus restreint dans le choix des légendes, et surtout marqué par le souci de les évoquer très librement, comme on le fait dans une conversation entre amis. Voici donc un livre d’initiation, aussi simple et ludique que possible, que l’on pourra lire à sauts et à gambades, comme le disait Montaigne. Il s’agit de raconter la pensée, et de donner en peu de pages des repères essentiels, tirés des grands moments de la culture, pour aider à la réflexion sur les choses de la vie.
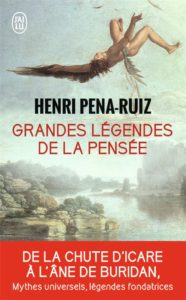
PENA-RUIZ Henri, Grandes légendes de la pensée est paru chez J’AI LU en 2015. Il est aujourd’hui épuisé
FR
EAN 9782290020029
187 pages
Disponible en poche
Bonnes feuilles…
La vie parfois vacille et doute d’elle-même. Commencer, recommencer, sans cesse. Le constat de l’éternel recommencement des choses, semblable au cycle des saisons, la vie succédant à la mort et la mort à la vie, la croissance au déclin et le déclin à la croissance, produit une sorte d’angoisse. Le quotidien qui se livre sous le signe du recommencement mérite-t-il d’être vécu ? Peut-on croire au sens de ce que l’on fait, lorsqu’il faut toujours reprendre, toujours recommencer ?
Le rocher que Sisyphe était condamné à porter dévalait la pente que Sisyphe avait gravie, chaque fois qu’il atteignait le haut de la colline. Ce rocher de Sisyphe est devenu le symbole d’une tâche absurde à accomplir, puisque sitôt accomplie, elle doit être recommencée. À certains égards, n’est-ce pas tout le déroulement de la vie quotidienne qui peut être placé sous le signe du rocher de Sisyphe ? On se lève le matin, on se prépare, on va travailler, on revient, on recommence le lendemain. Ainsi disait-on naguère des ouvriers qui allaient à l’usine : « Métro, boulot, dodo », « Métro, boulot, dodo », et ce recommencement semblait dessaisir la vie de toute signification.
Mais la conscience humaine interroge : pourquoi ? Camus raconte qu’à un moment ou à un autre de cet enchaînement machinal quotidien, la question du pourquoi s’élève. Il faut poser la question du pourquoi, il faut réfléchir sur cette apparence d’éternel recommencement, sur cette apparence d’absurdité qui pourrait bien, si l’on n’y prend pas garde, dessaisir la vie elle-même de toute signification. La méditation sur la tâche de Sisyphe reprend cette interrogation. Albert Camus, dans le Mythe de Sisyphe, raconte :
À cet instant subtil où l’homme se retourne sur sa vie, Sisyphe revenant vers son rocher, contemple cette suite d’actions sans lien qui devient son destin. Créé par lui, uni sous le regard de sa mémoire et bientôt scellé par sa mort. Ainsi, persuadé de l’origine tout humaine de tout ce qui est humain, aveugle qui désire voir et qui sait que la nuit n’a pas de fin, il est toujours en marche. Le rocher roule encore. Je laisse Sisyphe au bas de la montagne. On retrouve toujours son fardeau. Mais Sisyphe enseigne la fidélité supérieure qui nie les dieux et soulève les rochers. Lui aussi juge que tout est bien. Cet univers désormais sans maître ne lui paraît ni stérile ni futile. Chacun des grains de cette pierre, chaque éclat minéral de cette montagne pleine de nuit à lui seul forme un monde. La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.
Sisyphos, en grec, c’est « le très sage ». Le héros de Camus était légendairement connu pour son intelligence, mais aussi pour la démesure, en grec hubris, par laquelle il voulait, en quelque sorte, s’égaler aux dieux. Sisyphe, l’être qui voulait non pas nier la divinité, mais s’en passer, voire s’égaler à elle. D’où le châtiment qui lui rappelle à la fois sa force et sa faiblesse, et va l’obliger à l’effort sans cesse répété des êtres mortels. La force, c’est celle de Sisyphe capable de rouler son rocher jusqu’en haut de la colline, la faiblesse, c’est la vanité d’un tel travail, dès lors qu’au dernier moment le rocher dévale de toute sa force jusqu’au bas de la colline, avec obligation pour Sisyphe de tout recommencer. Il faut porter le fardeau quotidien, quoi qu’il en coûte.
Dans le onzième chant de L’Odyssée, Homère décrit l’effort de Sisyphe et son inexorable recommencement.
Ses deux bras soutenaient la pierre gigantesque et des pieds et des mains, vers le sommet du tertre, il la voulait pousser. Mais à peine allait-il en atteindre la crête qu’une force soudain la faisant retomber, elle roulait au bas, la pierre sans vergogne. Mais lui, muscles tendus, la poussait derechef, tout son corps ruisselait de sueur et son front se nimbait de poussière.
On reconnaît là le châtiment de la tâche sans cesse recommencée, comme celle des Danaïdes, ces nymphes des sources que la légende représente aux enfers, versant indéfiniment de l’eau dans des tonneaux sans fond. Pourquoi ? La question du sens des actions s’étend très vite à celle du sens de la vie. Dans le ciel dont les dieux se sont absentés, nul signe désormais n’est adressé aux mortels, qui sont seuls devant leur tâche. Il leur faut conduire leur vie, la reconduire, de jour en jour, et l’effort pour le faire suffit à leur condition. L’homme va s’inventer les moyens de persévérer dans son être. Depuis Prométhée, il est capable de produire son existence. Sisyphe, un instant, s’arrête. Au moins intérieurement. Et alors va s’esquisser la sagesse toute simple d’une interrogation première. Quelle vie voulons-nous vivre et quel bien mérite d’être recherché pour lui-même ? Question essentielle qui appelle une réflexion pour aller vers la sagesse. La tâche de la vie se redéfinit. Non, le recommencement qui appartient à la vie des hommes mortels ne peut pas disqualifier cette vie. Et Sisyphe lève les yeux vers le ciel. Ce ciel est désert. Soit. Mais lui, Sisyphe, trouvera dans la tâche quotidienne qui est la sienne les ressources même pour vivre heureux.
Sisyphe ne peut se réconcilier avec la vie qu’en prenant la mesure de ce monde où il va inscrire sa destinée. Sa force renaîtra toujours s’il décide, une fois pour toute, de vivre sa vie d’homme, de se passer de ces dieux qui sont tour à tour protecteurs et menaçants. La peur n’est plus de mise, ni la lassitude. Les rythmes quotidiens ne sont pas l’essentiel. Ils rendent la vie possible, tout simplement, sans préjuger de la direction qui l’accomplira. À l’homme de construire son monde et de dessiner les contours de son bonheur, de façon tout à fait inédite. Sisyphe ne peut pas reprendre à son compte la fameuse phrase de Dostoïevski : « Si Dieu n’existe pas, tout est permis. » Pour Sisyphe, l’humanité maîtresse d’elle-même porte seule son fardeau, mais elle est ainsi habilitée à définir seule les valeurs qui lui permettront de vivre le mieux possible.
De cette façon, un nouveau bonheur va prendre forme sur le fond de l’absurdité initiale. Celle-ci est dépassée, transcendée. L’homme se dresse et il va assumer son humaine condition. Un humanisme se dessine qui est celui d’une patience. Patientia, en latin, c’est tout à la fois la souffrance et la capacité à endurer. Vertu stoïcienne par excellence. Sisyphe s’était révolté contre les dieux qui, pour le punir, lui avaient assigné cette tâche absurde : monter et descendre, monter et descendre !
Sénèque, dans la treizième lettre à Lucilius, évoque la leçon d’espérance de l’homme qui compte désormais sur lui-même.
Tu as une grande force d’âme, je le sais, car avant même de te munir des préceptes salutaires qui triomphent des moments difficiles, tu te montrais, face à la fortune, suffisamment décidé. Tu l’es devenu beaucoup plus après avoir été aux prises avec elle et avoir éprouvé tes forces.
Éprouver ses forces, c’est effectivement ce que vient de faire Sisyphe. Alors, avant de le reprendre, en sueur mais intérieurement rasséréné, il va contempler son rocher et se dire que la montée de la colline suffit à remplir un cœur d’homme.
Deux paroles de méditation en complément. La première porte sur la double signification du terme absurde devenu un substantif dans la philosophie de l’absurde. La deuxième évoque la disqualification du monde terrestre du point de vue de la religion chrétienne, à partir du texte biblique de l’Ecclésiaste.
Qu’est-ce que l’absurde ? L’adjectif, rapidement transformé en un nom, en un substantif, désigne soit ce qui n’a aucun sens, aucune raison, soit ce qui n’a aucune finalité. Ainsi, par exemple, si un homme s’attache à construire une œuvre, et que cette œuvre est soudainement détruite, il aura le sentiment d’une absurdité, puisque son activité aura été dessaisie de tout intérêt. Cela peut être aussi l’idée, par extension, que ce qui est destiné à mourir, à périr, n’a finalement pas de véritable finalité. Sens que l’on retrouve dans la disqualification religieuse de l’existence humaine, qui est l’existence condamnée à la vanité, c’est-à-dire condamnée à l’inutilité, à l’absence même de signification, puisque toute chose, sous le ciel, est destinée à périr. Dans le sens habituel, donc, absurde signifie contraire à la raison et au sens commun : est absurde ce qui est déraisonnable, insensé, voire extravagant. Dans le sens philosophique, par extension, est absurde ce qui ne peut être justifié par aucune finalité, par aucune raison d’être. Et une méditation sur la vie humaine en tant qu’elle se termine par la mort peut déboucher sur le sentiment de l’absurdité. De la même façon, est absurde toute activité qui ne débouche pas, qui est en quelque sorte invalidée par la destruction de ce qu’elle a permis de faire.
C’est dans le cadre de la religion chrétienne que l’idée de l’absurdité de tout ce qui est destiné à mourir, donc de l’existence terrestre, est soulignée. La théologie, qui vise à montrer que l’essentiel se trouve dans la croyance en un dieu et un au-delà, aboutit à la disqualification de tout ce qui existe sur terre. Un grand texte de la Bible a souligné l’absurdité qui tient au recommencement, à l’éternel recommencement des choses. C’est un extrait de l’Ecclésiaste que l’on peut citer ici pour montrer comment une conception de l’absurde peut s’enraciner dans la disqualification religieuse de l’existence terrestre. Paroles de l’Ecclésiaste, fils de David :
Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l’homme de toute la peine qu’il se donne sous le soleil ? Une génération s’en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche ; il soupire après le lieu d’où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord ; puis il tourne encore, et reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n’est point remplie ; ils continuent à aller vers le lieu où ils se dirigent. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu’on peut dire ; l’œil ne se rassasie pas de voir, et l’oreille ne se lasse pas d’entendre. Ce qui a été, c’est ce qui sera, et ce qui s’est fait, c’est ce qui se fera, il n’y a rien de nouveau sous le soleil. S’il est une chose dont on dise : « Vois ceci, c’est nouveau! » cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés.
Et, de ce constat de l’éternel recommencement des choses – « rien de nouveau sous le soleil » dit le proverbe -, l’Ecclésiaste tire la conclusion d’une sorte de vanité de l’existence terrestre.
J’ai vu tout ce qui se fait sous le soleil ; et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut se redresser, et ce qui manque ne peut être
compté. J’ai dit en mon cœur : Voici, j’ai grandi et surpassé en sagesse tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J’ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse, et à connaître la sottise et la folie; j’ai compris que cela aussi c’est la poursuite du vent.
On voit que cette insistance sur la vanité des choses, sur l’absurdité des choses qui naissent et meurent, débouche, dans le texte de l’Ecclésiaste, sur un noir optimisme, puisque c’est l’idée même d’une sagesse humaine qui s’en trouve disqualifiée. A l’ opposé, il faudra qu’un être humain qui meurt, qui recommence, prenne la mesure de son pouvoir. La signification positive du personnage emblématique de Sisyphe sera ainsi soulignée. On pense aussi à ce que Nietzsche écrira en évoquant le thème de l’éternel retour. Certes, pour le philosophe, il y a un éternel retour, mais ce n’est pas cela qui dessaisit l’existence humaine de toute signification.
Henri Peña-Ruiz, Grandes légendes de la pensée (extrait, 2015)
L’auteur…
[ATHEISME.FREE.FR] Henri PENA-RUIZ est né en 1947. Il est maître de conférence à l’Institut d’études politiques de Paris et professeur agrégé de philosophie en Khâgne (classe supérieure classique) au lycée Fénelon. Philosophe et écrivain défendant les valeurs de solidarité, il est devenu un spécialiste des questions de laïcité qu’il pose comme fondement de l’universalité. C’est à ce titre qu’il a été en 2003, l’un des vingt sages de la commission sur la laïcité présidée par Bernard Stasi.
Henri Pena-Ruiz classe la croyance au rang des « options spirituelles », au même titre que l’agnosticisme et l’athéisme. Il s’oppose à l’instrumentalisation de la religion, celle qui mène à la Saint-Barthélemy, et veut donner à la laïcité toute sa dimension universaliste. Dans Dieu et Marianne, il développe une philosophie de la laïcité. Marianne n’étant ni athée ni croyante, c’est la République qui offre le plus de liberté aux croyances religieuses. Mais il ne faut surtout pas concéder aux religions le droit de contribuer aux décisions d’ordre politique.
Il dénonce la laïcité « ouverte » ou « plurielle » comme étant une contestation dissimulée des principes de la laïcité, qui, par définition, est ouverte. Quant au repli communautaire, il est stigmatisé par la discrimination dont sont victimes les populations d’origine maghrébine. Pour lui, la justice sociale et les « dispositifs juridiques » (lois) sont des moyens complémentaires de défendre la laïcité.
Dans Le roman du Monde, il montre, à travers les légendes et les mythes fondateurs de la philosophie, quelles sont les grandes questions qui interpellent encore l’homme du XXIe siècle (angoisse face à la mort, désir de progrès techniques…).
Quelques ouvrages : Les Préaux de la République (1991), La Laïcité (1998), L’Ecole (1999), Dieu et Marianne, Philosophie de la laïcité (1999), La laïcité pour l’égalité (2001), Le roman du Monde (2001), Un poète en politique, les combats de Victor Hugo (2002), Qu’est-ce que la laïcité ? (2003), Leçons sur le bonheur (2004), Histoire de la laïcité, Genèse d’un idéal (2005), Dictionnaire amoureux de la laïcité (2014).
En savoir plus…
-
-
- WALLONICA : Le rocher de Sisyphe ou Le courage de vivre.
-
[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : librel.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © sudouest.fr.
Lire encore en Wallonie-Bruxelles…