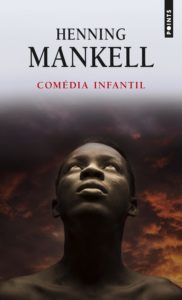Ce qu’ils en disent…
Il y a dans ce livre des accents poétiques, une tendresse à fleur de peau qui se marie avec la perception d’un monde inexorable.
Madame Figaro
[EDITIONSPOINTS.COM] Quelque part en Afrique, la nuit, un homme assis sur le toit d’un théâtre contemple la ville. A ses pieds, allongé sur un matelas, un enfant blessé par balle est en train de mourir. Nelio, dix ans, possède pourtant la sagesse et l’intelligence d’un vieil homme… Pendant les neuf nuits qui lui restent à vivre, il va raconter l’histoire de sa vie.
Tandis que la guerre civile faisait rage, Nelio, alors âgé de six ans, a été l’unique rescapé de la mise à sac de son village. Après une période d’errance ponctuée de rencontres étranges, il finit par se retrouver en ville et par rejoindre un groupe d’enfants des rues. Un jour, il est blessé mortellement par un gardien du théâtre qui le prend pour un voleur.
Le narrateur est José Antonio Maria Vaz, un simple boulanger africain qui a connu la domination portugaise et qui, comme dans les Mille et Une Nuits, recueille le récit de Nelio, suspendu aux premières lueurs du jour jusqu’à la nuit suivante.
Tel est le conte humaniste, cruel et tendre à la fois, que Henning Mankell ciselle de main de maître, abordant, au-delà de l’histoire de Nelio, tout autant la misère dans les État ruinés d’Afrique après l’ère coloniale, que maints aspects de l’existence humaine : le rôle de l’art et de l’imagination chez l’individu, les forces mystérieuses qui nous gouvernent et le sens de la vie.
[AFRICINE.ORG] On pouvait craindre le pire : un film réalisé par une Occidentale sur les enfants des rues au Mozambique d’après le roman d’un auteur à succès suédois. La surprise est d’autant plus grande : Comédia infantil, qui laisse l’enfant Nelio raconter sa dramatique histoire dans un Mozambique en guerre, est attachant sans verser dans le sentimentalisme, magique sans être niais, engagé sans brandir de pancarte et beau sans carte-postale. Tout tient bien sûr dans la manière de traiter le sujet. On retrouve dans cette écriture cinématographique quelque chose de Marguerite Duras : des plans lacunaires et incisifs centrés sur des détails signifiants, une stylisation générale évitant systématiquement tout effet esthétisant, et en définitive un étonnement ménagé au spectateur à chaque image. Un enfant raconte son histoire mais c’est d’une réécriture qu’il s’agit. Une distance littéraire (il réfléchit ce qu’il vit) vient renforcer une distance théâtrale (il rejoue son histoire pour finalement déboucher sur une scène de théâtre). Si bien que le réalisme des détails donne paradoxalement naissance à une atmosphère irréelle, où la magie trouve une place toute naturelle. Cela n’empêche pas l’identification mais nous dispense des larmes, car l’émotion ressentie ne provient pas d’une peur de ce qui nous arriverait si on était à la place de l’enfant mais davantage du réveil en soi d’une compréhension sensible du cycle de la vie et de la mort, du drame de la guerre, de la magie de la vie.
On retrouve la subtilité développée dans Kirikou la sorcière de Michel Ocelot et l’on peut souhaiter au film le même succès tant chez les jeunes que chez les adultes. Il n’y a pas de hasard : tout comme Ocelot a puisé dans son enfance guinéenne, Henning Mankell, l’auteur du livre dont est tiré le film, vit au Mozambique où il dirige le Théâtre Avenida qui sert de décor au film. La réalisatrice vit elle-même entre Portugal et Suède et l’on retrouve dans le film certaines obsessions de la culture portugaise (culture coloniale : il appartiendrait à un auteur mozambicain d’en déceler les ambiguïtés) comme l’inscription de la violence dans le cycle de la vie ou la recherche d’un monde spirituel intermédiaire. Aux soldats portant des masques de mort qui vont jusqu’à écraser un enfant dans un mortier s’oppose une femme-lézard qui sauve et initie à la fois. Le film devient ainsi une série d’étapes initiatiques où l’enfant Nelio engrange les expériences lui permettant d’affirmer les valeurs de vie qui permettront à cette société de sortir de la guerre. Comme dans le final du magnifique Mortu Nega (Ceux dont la mort n’a pas voulu) du Bissau-Guinéen Flora Gomes, une rencontre est proposée entre les morts et les vivants pour pouvoir danser sur la scène du théâtre de la vie. Le boulanger, qui a écouté durant tout le film l’histoire de Nelio, peut alors généreusement offrir ses croissants aux enfants des rues et quitter son état de soumission pour partir sur le chemin de l’autonomie.
Olivier Barlet
MANKELL Henning, Comédia infantil est paru en suédois en 1995 puis en français chez Points en 2003, dans une traduction de Agneta Segol et Pascale Brick-Aïda. Il est réédité chez Points depuis 2016.
SV > FR
EAN 9782020799072
288 pages
Ce que nous en disons…
La maîtrise de Mankell permet une émotion contenue d’une rare intensité, l’horreur est évidente mais sans l’indécence du pathos, l’humanité rayonne à chaque page. C’est une Afrique qui sonne juste, profonde et incarnée, sous la plume d’un suédois qu’on a connu plus détaché.
Nous étions déjà sous le charme des deux récits non-policiers de Mankell (Les chaussures italiennes en 2019 et Les bottes suédoises en 2020). C’est un souffle plus large encore qui habitait l’histoire de José Antonio Maria Vaz et de Nelio, quelques années auparavant. A lire d’urgence…
Bonnes feuilles…
Moi qui porte le nom de José Antonio Maria Vaz, j’attends la fin du monde debout sur un toit en terre rouge brûlée par le soleil. La nuit sous le ciel étoilé des Tropiques est suffocante et humide. Je suis sale et fiévreux. Mes vêtements en lambeaux semblent vouloir se détacher de mon corps décharné. J’ai de la farine dans mes poches et elle est pour moi plus précieuse que l’or. Il y a un an, j’étais encore quelqu’un, j’étais boulanger, alors qu’à présent je ne suis plus personne. Je ne suis plus qu’un mendiant qui passe ses journées à errer sous le soleil brûlant, et ses nuits interminables à attendre sur le toit vide d’une maison. Mais les mendiants possèdent aussi leurs signes, qui leur assurent une identité et les distinguent de tous ceux qui exposent leurs mains au coin des rues, comme pour les offrir ou pour vendre leurs doigts, les uns après les autres. José Antonio Maria Vaz est ce miséreux connu sous le nom du Chroniqueur des Vents. Mes lèvres bougent sans relâche, jour et nuit, comme pour raconter une histoire que personne n’a jamais eu le courage d’écouter. J’ai fini par accepter que la mousson venant de la mer soit mon unique auditeur, toujours aussi attentif, patient comme un vieux curé qui attend la fin de la confession. […]
La dernière nuit
Le soleil était tout près de mon âme le dernier jour où Nelio était encore en vie. Quand je vidais mes poumons, l’air s’embrasait pour retomber ensuite sur le pavé comme des cendres noires. Jamais, ni avant ni après, je n’ai connu une chaleur aussi intense. Impossible de trouver de la fraîcheur. Même le vent, qui venait de la mer, haletait d’épuisement. J’errais nerveusement dans les rues, me glissant, quand je le pouvais, dans des endroits ombragés et secs où les gens cherchaient vainement un peu de répit. Un étourdissement croissant menaçait de me jeter à terre. Je ne savais plus très bien où j’en étais. J’avais l’impression que tout ce qui m’arrivait était une erreur qui ne concernait personne et dont personne n’était vraiment responsable. Pour la première fois,je voyais le monde tel qu’il était. Ce monde dont Nelio avait perçu le secret avant même d’être adulte.
Et qu’est-ce que je voyais ? Le moteur d’un tracteur hors d’usage gisait là comme un poème narquois pour me parler de ce monde qui était en train d’éclater sous mes yeux. Un enfant de la rue fouettait violemment la terre comme pour la punir de sa propre misère. Un vautour solitaire planait silencieusement au-dessus de ma tête. Il se laissait porter par les vents ascendants, insensible aux rayons du soleil qui essayaient de percer son plumage. Son ombre me frappait de temps à autre comme une masse métallique et me pressait contre le sol. J’ai vu un vieil homme noir, tout nu, qui se lavait à une pompe. Malgré la chaleur, il frottait énergiquement son corps comme s’il voulait arracher sa vieille peau usée. Sous le soleil impitoyable, j’ai découvert, ce jour-là, le vrai visage de la ville. J’ai compris que les pauvres, trop occupés à se débattre sur le fil ténu de la survie, n’avaient pas le temps de préparer leur vie et étaient forcés de la consommer à l’état brut. J’ai vu ce temple de l’absurde qu’était la ville, qu’était peut-être aussi le monde, à l’image de ce qui m’entourait. Je me trouvais en réalité au beau milieu de la cathédrale sombre de l’impuissance. Ses murs s’écroulaient lentement en soulevant une poussière épaisse. Ses vitraux multicolores avaient disparu depuis bien longtemps déjà. Autour de moi, je ne voyais que des pauvres. Les autres, les riches, évitaient les rues et s’abritaient dans l’enceinte de leurs bunkers où des machines chuintantes maintenaient une fraîcheur constante. Le monde n’était plus rond. Il était redevenu plat et la ville était située à son bord extrême. Si jamais les maisons se faisaient de nouveau balayer des pentes escarpées par de violentes pluies, elles ne seraient plus précipitées dans le fleuve, mais dans un gouffre sans fond.
Ce jour-là, la ville semblait être la victime d’une invasion subite, non pas de sauterelles, mais de prêcheurs. Ils étaient partout, perchés sur des caisses, des cartons, des palettes ou des poubelles. Le visage ruisselant de sueur, ils tentaient d’attirer les gens en usant de leur voix plaintive et de leurs mains suppliantes. Des hommes et des femmes les ont rejoints. Ils balançaient leur corps en fermant les yeux, espérant trouver un changement radical au moment de les rouvrir. Certains se tordaient convulsivement par terre, d’autres s’éloignaient en rampant comme des chiens battus, d’autres encore jubilaient pour des raisons qui m’échappaient. Moi qui avais toujours cru que l’Apocalypse se déroulerait sur fond de pluie, de nuages noirs déchiquetés, de tremblements de terre et sous un millier d’éclairs, je m’apercevais que je m’étais trompé. C’est sous un soleil de plomb que le monde allait disparaître. Nos ancêtres – sans doute des millions -, ne pouvant plus supporter la souffrance que les vivants s’infligeaient les uns aux autres, s’étaient réunis pour que nous nous retrouvions tous ensemble dans l’autre monde, après la chute dans le néant. Les rues que j’arpentais ne seraient alors plus qu’un souvenir dans la mémoire de ceux qui n’avaient pu apprendre à oublier.
Je suis passé devant une maison où un homme, pris de folie, était en train de lancer ses meubles par la fenêtre. Il appelait sans cesse son frère Fernando qu’il n’avait pas revu depuis le début de cette guerre que les bandits avaient imposée à notre pays. Je l’ai vu au moment où il jetait son lit. En heurtant le trottoir, le matelas s’est éventré et le bois a éclaté. Je ne sais toujours pas pourquoi j’ai poursuivi mon chemin. Pourquoi je ne lui ai pas dit de s’arrêter. Je me le demande encore.
Le dernier jour où Nelio était encore en vie reste pour moi comme la longue représentation d’un rêve dont je n’aurais gardé que des souvenirs partiels. Quelque chose était sur le point de se terminer dans mon existence, et soudain j’ai commencé à comprendre le véritable sens du récit de Nelio. J’avais peur de l’inévitable. Peur que son histoire ne s’achève. Peur que tout soit révélé et qu’il meure des suites de sa terrible blessure à la poitrine. Finalement, l’unique chose que la vie nous offre gratuitement, à nous les pauvres, aux gens comme Nelio et moi, c’est la mort.
Nous sommes forcés de consommer la vie à l’état brut. Et après … il n’y a plus que la mort qui nous attend.
Il ne nous est jamais donné d’envisager le lendemain sans crainte. Nous n’avons jamais le temps de préparer la joie ou d’astiquer nos souvenirs pour les faire briller. […]Moi, José Antonio Maria Vaz, seul sur un toit, sous le ciel étoilé des Tropiques, j’ai une histoire à raconter…
L’auteur…
Henning Mankell, né en 1948 dam le Harjedalen, vit entre le Mozambique et la Suède. Écrivain multiforme, il est l’un des maîtres incontestés du roman policier suédois. Sa série centrée autour de l’inspecteur Wallander, et pour laquelle l’Académie suédoise lui a décerné le Grand Prix de littérature policière, décrit la vie d’une petite ville de Scanie et les interrogations inquiètes de ses policiers face à une société qui leur échappe. En France, il a reçu le prix Mystère de la critique, le prix Calibre 38 et le Trophée 813. Il est aussi l’auteur de romans ‘africains’ empreints de réalisme poétique. Couronné par plusieurs prix littéraires, Comédia infantil a été adapté à l’écran en 1998 (Prix spécial Cannes junior 1999).
En savoir plus…
- Comédia infantil, un film de Solveig Nordlund : 1997, Suède (Torromfilm) – Portugal (Prole Filme) – Mozambique (Avenida Produções), 92 mn, 35 mm, dolby. Distr. Cinema public films (01 47 57 36 36). Sortie France le 9 février | Résumé : L’histoire de Nélio, un gamin mozambicain, dont le destin est bouleversé par la guerre. Sa famille est décimée par les terroristes. Conduit dans un camp pour enfants soldats, il s’échappe, gagne la ville et devient le chef d’une bande des rues. Peu à peu, les gens commencent à lui prêter des pouvoirs de guérisseur, sa réputation grandit et on vient vers lui pour chercher du secours et repousser la mort. Mais la guerre le rattrape…
[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : editionspoints.com ; librel.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © vozpopuli.com.
Lire encore en Wallonie-Bruxelles…