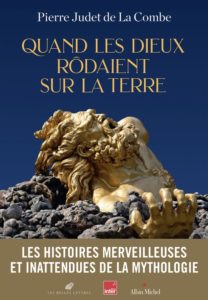Ce qu’ils en disent…
[ALBIN-MICHEL.FR] Zeus, Aphrodite, Athéna, Dionysos, Apollon… Tous les secrets des Dieux et des Déesses qui rôdaient autrefois sur la Terre. Pierre Judet de La Combe nous fait voyager à travers les nombreux mythes de la mythologie : histoires merveilleuses, invraisemblables, inattendues. Un livre pour revivre l’expérience de ce monde ancien et surprenant, où l’Océan, les Fleuves, le Soleil ne sont pas des éléments désincarnés, mais s’adressent aux habitants de la Terre, où les puissances invisibles qui décident des vies et des sociétés humaines descendent de l’Olympe ou surgissent des entrailles de la terre ou de la mer pour se montrer, parler et s’affronter aux humains.
Réunis dans un livre, ces récits ne perdent rien de leur charme addictif.
Le Monde
[LESBELLESLETTRES.COM] Il était une fois, en Grèce, des êtres extraordinaires. Ce sont leurs histoires qui nous sont ici racontées. Des histoires merveilleuses, invraisemblables, inattendues, qui nous propulsent de Troie à Thèbes, et aux limites du monde, entre Ciel et Terre.
Véritable voyage à travers la mythologie, ce livre, qui reprend la première saison de l’émission de France Inter Quand les dieux rôdaient sur la Terre, fait revivre un monde ancien et surprenant, où l’Océan, les Fleuves, le Soleil ne sont pas des éléments désincarnés, mais s’adressent aux habitants de la terre, où les puissances invisibles qui décident des vies et des sociétés humaines descendent de l’Olympe ou surgissent des entrailles de la terre ou du fond des mers pour se montrer, parler et faire face aux humains.
Apollon, le voyou magnifique ; Artémis, belle et féroce ; Hermès, fourbe et farceur ; Prométhée, le voleur de feu… Pierre Judet de La Combe nous rappelle que, si les mythes nous parlent encore aujourd’hui, c’est parce qu’ils cherchent à expliquer la finitude humaine, et que, dans un monde sans salut, ils font surgir en nous le plaisir d’un imaginaire libre et merveilleux, qui permet de se repérer dans les brutalités de la vie.
[PHILOMAG.COM] Tous les samedis matin, l’helléniste Pierre Judet de La Combe ramène les auditeurs de France Inter au temps où les dieux se mêlaient aux humains, ne lésinant pas sur les apparitions sous déguisement et les signes plus ou moins cryptiques. Présenter le corpus mythologique sous un angle neuf n’est pas chose facile : qu’ont encore à nous apprendre Héraclès, Médée, Thésée ou Dionysos ? Pierre Judet de La Combe raconte et revient ainsi aux sources de la poésie grecque, de la transmission orale de récits qui n’avaient rien d’un divertissement mais participaient de la vie spirituelle et politique. Le dieu de l’ivresse et des excès se rapporte ainsi à une certaine appréhension du temps rythmé par les célébrations et la musique, celle des tambours et autres percussions, et non pas celle, harmonieuse, de la lyre d’Apollon. Le voleur de feu Prométhée n’est pas le rebelle que l’on croit mais plutôt le complice d’un Zeus qui s’ennuie de régner sur un monde à l’équilibre trop parfait : y intégrer les humains permet de ramener de l’imprévu, de l’excitation, sans trop non plus menacer l’ordre des dieux. La mère infanticide Médée est peut-être la véritable outsider : alors que Jason la délaisse pour une autre et pour un meilleur statut social, comme n’importe quel mari grec aurait pu le faire, elle se révolte, traite les hommes de « piètres raisonneurs. » On sait la violence du geste qu’elle accomplira – un mystère, commente l’auteur. C’est à toucher un peu de l’énigme de cette civilisation à la fois si proche et lointaine que nous invitent les histoires de Pierre Judet de La Combe : une odyssée à traverser bien au chaud sur son canapé.
JUDET de LA COMBE Pierre, Quand les Dieux rôdaient sur la Terre est paru chez Albin Michel en 2024.
FR
EAN 9782226498236
608 pages
Disponible en grand format et ePub.
Ce que nous en disons…
Quelle belle approche ! Habile conteur, Pierre Judet de La Combe (eh oui, il y a des gens qui s’appellent comme ça…) réussit à nous rendre familière l’intrication des dieux grecs et les contradictions kafkaiennes de leurs actions parmi les humains. On est dans de « l’anti-Marvel » : l’auteur renonce dans chaque chapitre à faire l’hagiographie d’un super-héros spécifique, et rend la complexité des interventions de ceux-là qui trônent sur l’Olympe mais descendent parmi nous rebattre les cartes du quotidien. C’est un helléniste éclairé qui raconte combien les péripéties des différents mythes sont variées et liées au conteur lui-même. Ce faisant, il sait isoler la dorsale profonde de chaque histoire, là où est la leçon immuable qui, déjà dans l’Antiquité, animait la pensée des humains face à ce mystérieux déroulé de phénomènes qu’on appelle depuis longtemps… la Vie.
Bonnes feuilles…
THESEE SERIAL LOVER, SAISON 2 : PHEDRE
Quand les dieux rôdaient sur la Terre…
Il y a très longtemps, en Grèce, il fallait faire très attention avec les dieux. Ils étaient grands, forts, immortels, ils étaient parfois aimants, généreux, aidants, si on savait les prier comme il fallait et leur adresser les bons sacrifices, mais ils étaient aussi très capricieux, comme des gosses. Ils avaient beau être grands, forts, immortels comme doivent l’être des dieux et des déesses normalement constitués, ils avaient aussi une forte tendance à réagir comme nous, les humains. Ils étaient susceptibles, jaloux, colériques, râleurs, mesquins. Si on ne les aimait pas assez, ils devenaient furieux, exactement comme nous.
Nous, les humains, nous étions pour ces dieux des presque rien, des petits mortels voués à vieillir, puis à disparaître, tout leur contraire. Mais ce que les dieux et les déesses aimaient le plus, c’était notre vénération, notre amour, et toutes les offrandes que l’on pouvait leur faire sur leurs autels, lors des sacrifices. Si un dieu se sentait négligé, c’était la catastrophe. En fait, les dieux dépendaient entièrement de nous, les humains.
Les dieux nous regardaient d’en haut, depuis leur Olympe, ou au contraire d’en bas, depuis le fond des mers ou depuis le fin fond de la terre, et ils avaient du mépris pour nos faiblesses, pour notre incapacité à nous guérir de la mort. Nous voir maladroits, malhabiles, peu adaptés à ce monde qu’ils administraient, cela les faisait rire. Mais ils n’attendaient qu’une chose : qu’on leur rende hommage. Sinon, c’était la crise. Ils devenaient méchants, les dieux aussi bien que les déesses, ce qui les amusait : ils y prenaient plaisir. Ils montraient par là qu’ils étaient vraiment les plus forts, eux, les dieux Bienheureux.
Le problème, pour les humains, c’était qu’il y en avait beaucoup, de dieux et de déesses. Il fallait les aimer tous, ou les redouter tous, en leur faisant suffisamment d’offrandes pour qu’ils soient tous bienveillants. Il ne fallait en oublier aucun, et on ne pouvait pas vraiment faire son choix et préférer tel ou tel dieu. Si on aimait trop l’un, ou l’une, une autre divinité pouvait se fâcher, se sentir lésée. Alors, elle frappait fort. Pas seulement pour nous punir, mais aussi pour faire la nique à l’autre dieu, à celui ou celle qui avait été trop aimé, aux dépens des autres. Les dieux se vengeaient entre eux. Bref, ces dieux étaient comme nous.
On pourrait se dire que tout cela ne fait pas une vraie religion, que c’est infantile, un peu bébête, ces dieux perpétuellement jaloux, entre eux et vis-à-vis des humains. De nombreux philosophes de l’Antiquité l’ont pensé, et ils ont protesté contre ces histoires monstrueuses de dieux mesquins, cruels, prêts à tous les vices, des dieux beaucoup trop humains. Ils n’en voulaient plus. Ils voulaient des dieux parfaits, purs, vraiment divins. Mais, Dieu merci, on ne les a pas trop écoutés, pendant longtemps.
En effet, ils sont vraiment intéressants ces dieux, et utiles. Comme ils sont toujours en rivalité les uns avec les autres, comme ils ne se font pas de quartier (sauf quand ils se réunissent pour faire la fête, boire et chanter dans l’Olympe), ils nous rappellent ce qu’est le monde : complexe, difficile, opaque, traversé de forces contradictoires, en opposition les unes aux autres.
On ne peut pas vivre, agir dans ce monde avec des idées trop simples, trop fermées. Il y a toujours un dieu, quelque part, qui peut concocter une mauvaise surprise. Il faut tout envisager, accepter que la réalité ne peut pas se comprendre d’un seul point de vue. Dans ce monde gouverné par les dieux, les humains devaient avoir une intelligence multiple, une « intelligence nombreuse« , comme dit le poète Homère à propos d’Ulysse, ce héros vif et tournoyant, qui a toujours su s’en sortir.
Cette rivalité entre divinités est bien ce qui a mené à sa perte la famille du héros Thésée, le fort et très beau Thésée, dont nous avons commencé à suivre la fabuleuse histoire. Histoire fabuleuse, mais qui montre aussi les faiblesses de ce grand homme, qui n’a pas toujours eu l’intelligence fine et multiple du merveilleux Ulysse, et qui s’est souvent retrouvé le bec dans l’eau, par ses propres fautes.
On a vu combien Thésée était, malgré ses défauts, adoré de la ville d’Athènes, qui en a fait son roi mythique, son véritable fondateur, son idole. Chéri des dieux, et notamment de celui qui passait pour être son père, Poséidon, dieu de la mer, il a accompli de grands exploits, estourbi toute une série de gens très méchants, qui maltraitaient leurs semblables, toute une série de bêtes féroces et monstrueuses, comme le gros taureau qui dévastait le pays de Marathon, au nord d’Athènes. Et, surtout, il a pris la mer et il est allé en Crète pour se battre victorieusement contre le Minotaure, dans le Labyrinthe. Si Thésée pouvait par sa force, par ses muscles, assommer sans trop de problème ce monstre à la fois bovin et humain, il n’aurait as pu échapper au Labyrinthe sans l’intelligence et l’amour d’Ariane, et sans l’aide de son fil. Les gros muscles de Thésée n’auraient pas suffi.
Cette expérience lui a appris que le monde était compliqué, difficile, impossible à maîtriser d’un seul regard. Thésée a eu à affronter un monstre double, animal et humain, dans un Labyrinthe dont la sortie était introuvable sans une ruse, le fil d’Ariane. Thésée a eu de la chance de pouvoir bénéficier de l’amour de quelqu’un d’autre. Seul, il n’aurait pas triomphé.
Ce Labyrinthe était à l’image de ce qu’est le monde pour les humains : une réalité inextricable, difficile à saisir, sans repère fixe, où l’on va et vient, où l’on ne cesse d’être ballotté entre un chemin puis un autre. Il fallait de la ruse pour s’en sortir, et avoir l’appui de quelqu’un. Mais Thésée a oublié tout cela, il n’a pas bien appris la leçon ; ou, plutôt, il est devenu comme le Minotaure, ou comme le Labyrinthe, un être double, indécis, confus, labyrinthique. Sans Ariane, il a perdu le fil.
Ainsi on se souvient que Thésée, après avoir juré un amour perpétuel à la belle riane, l’oublie finalement endormie sur la plage de Naxos, où il fait escale sur le chemin du retour vers la Grèce. Puis Thésée, décidément oublieux, oublie aussi son père, le roi Égée, qui lui avait demandé à son départ de hisser une voile blanche sur son navire, en cas de victoire. Égée qui guette le retour du bateau voit surgir au large une voile funèbre, toute noire et se tue en se jetant dans la mer.
Thésée revient à Athènes, à la fois en triomphateur et en fils afRigé. Ses oublis ne l’ont pas empêché d’être un très grand roi, dit-on. D’abord, il passe pour être le véricable fondateur de la cité d’Athènes. Il a fait de la grande politique, en agglomérant les différentes bourgades du pays en une seule cité, une véritable unité politique. Athènes, grâce à Thésée, est devenue un vaste ensemble territorial, qui réunissait à la fois la ville, la campagne et ses villages, et le bord de mer, dans une belle harmonie physique, humaine, religieuse et politique. Une cité unie.
Thésée a aussi créé les institutions équilibrées, stables et justes, qui permirent à cette grande unité de vivre, de prospérer. Il était même parfois considéré, lui le roi, comme le champion de la démocratie athénienne. Face à un roi étranger, tyrannique et menaçant, qui voulait le contraindre et lui faire la guerre, Thésée aurait dit fièrement:
Rien n’est plus ennemi d’une cité qu’un tyran.
D’abord, parce que avec un tyran, il n’y a pas de lois
communes. Un seul homme a le pouvoir et fait de la loi sa chose à lui, et il n’y a plus aucune équité.
Quand il y a des lois écrites, l’homme démuni
et le riche ont droit à une justice égale.
Les démunis ont la possibilité de s’en prendre
aux fortunés avec les mêmes mots, si on parle mal d’eux. Le petit l’emporte sur le grand, s’il a le droit pour lui. […]
Quand le peuple a l’autorité sur un pays,
il se réjouit de pouvoir compter sur de jeunes habitants. Le roi a cela en horreur.
Il tue les meilleurs, ceux dont il pense qu’ils réfléchissent,
car il tremble pour son pouvoir tyrannique. Comment une cité pourrait-elle rester forte si, comme l’épi dans une prairie de printemps, on extirpe la bravoure et on fauche la jeunesse ?
[Euripide, Suppliantes, v. 429-449]
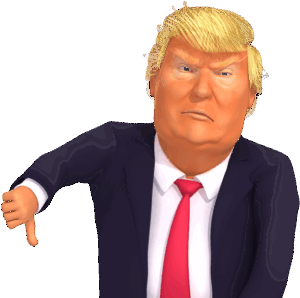
L’auteuR…
Pierre Judet de La Combe (né en 1949) est helléniste et philologue, directeur d’études à l’EHESS et directeur de recherche au CNRS. Il a traduit et commenté de nombreux textes de la poésie et du théâtre grecs et participé à plusieurs productions théâtrales (avec Ariane Mnouchkine, notamment). On lui doit, chez Albin Michel, la nouvelle traduction de l’Iliade (Tout Homère, 2019), et L’Avenir des Anciens. Oser lire les Grecs et les Latins (2016). Tous les samedis matin, sur France Inter, il anime l’émission à succès Quand les dieux rôdaient sur la Terre dont le livre est une adaptation.
[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : librel.be ; albin-michel.fr | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © telerama.fr.
Lire encore en Wallonie-Bruxelles…