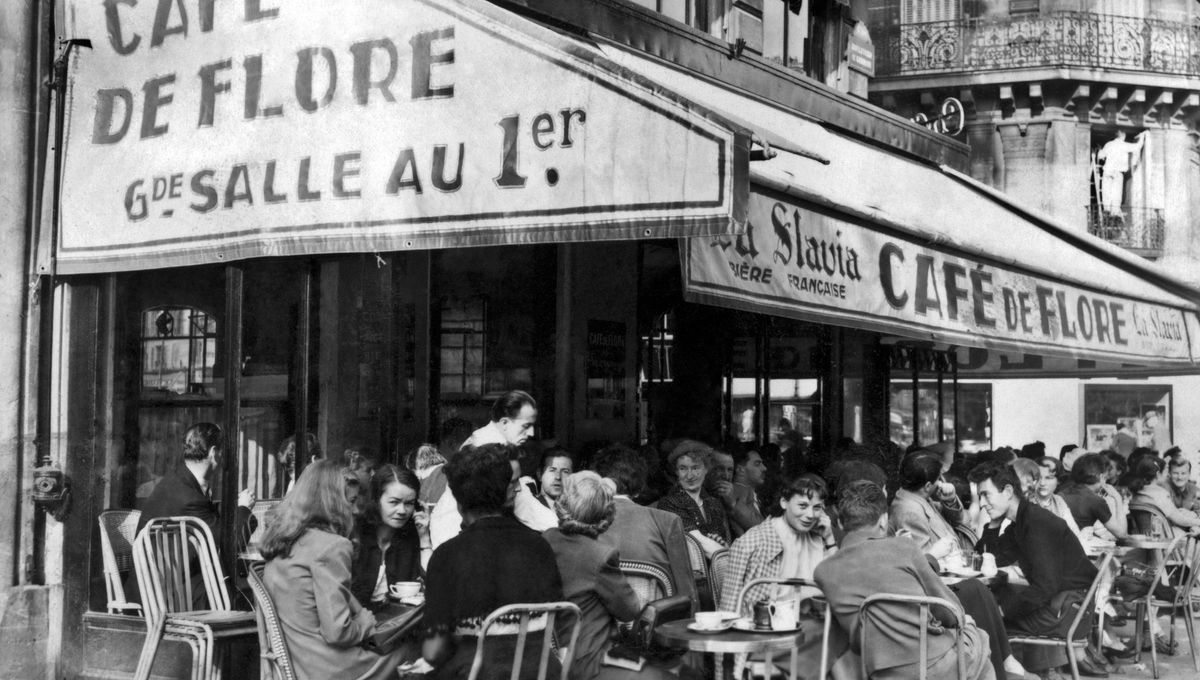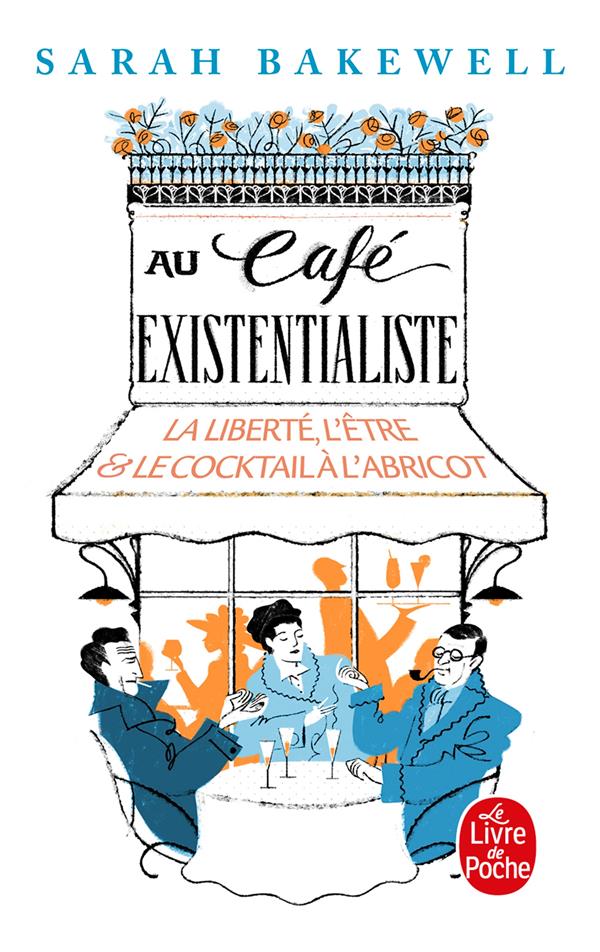Ce qu’ils en disent…
[LISEZ.COM] Êtes-vous, comme des millions de personnes, tombé dans le piège du bonheur ? Selon l’auteur, notre volonté d’être heureux à tout prix contribue à intensifier anxiété et dépression. Nous ne faisons alors que fuir nos problèmes au lieu de les apaiser et de les transformer. Grâce à cet ouvrage et à la thérapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy), une psychothérapie révolutionnaire basée sur les plus récentes recherches en psychologie du comportement, composez avec vos émotions douloureuses, surmontez le doute et l’insécurité, construisez-vous une vie riche et pleine de sens ! Le Dr Harris nous invite à cesser de lutter contre les pensées négatives : il s’agit d’accepter le malheur… pour mieux ouvrir la porte au bonheur !
—
[d’après YANNICK-LAMBERT.FR] L’ouvrage Le Piège du Bonheur de Russ Harris, basé sur les travaux de Steven C. Hayes, propose une alternative radicale à la quête incessante du bonheur. Il s’appuie sur la Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT) pour démontrer que nos tentatives pour éliminer la souffrance sont souvent ce qui nous rend malheureux.
Le Concept Central : Le Piège du Bonheur. L’auteur soutient que la culture occidentale est construite sur des mythes erronés concernant le bonheur, notamment l’idée qu’il s’agit d’un état naturel et permanent, et que toute émotion négative est un signe de dysfonctionnement. Cette croyance nous pousse dans un cercle vicieux : plus nous luttons contre nos pensées et émotions désagréables, plus elles prennent de l’ampleur et plus nous nous sentons défaillants. C’est ce qu’il nomme le piège du bonheur. Le livre explique que notre cerveau n’a pas évolué pour être heureux, mais pour survivre. Il est programmé pour anticiper le danger, évaluer, comparer et critiquer. Tenter de supprimer ce processus par la pensée positive est souvent une bataille perdue d’avance qui consomme notre énergie et nous éloigne de ce qui compte vraiment.
La Solution : La Thérapie d’Acceptation et d’Engagement (ACT). Plutôt que de chercher à contrôler notre monde intérieur, l’ACT nous invite à changer radicalement notre relation avec nos pensées et nos émotions. L’objectif n’est pas de se sentir bien en permanence, mais de construire une vie riche et pleine de sens, même en présence de la douleur. Pour ce faire, l’ACT repose sur six piliers fondamentaux :
-
-
- Défusion Cognitive : Apprendre à prendre du recul par rapport à ses pensées, à les voir comme de simples histoires que raconte notre esprit, plutôt que comme des vérités absolues ou des ordres à suivre.
- Expansion (Acceptation) : Faire de la place aux émotions et sensations désagréables sans les combattre. Il s’agit de les laisser être présentes et de les ressentir pleinement, ce qui diminue paradoxalement leur impact.
- Connexion au Moment Présent : S’ancrer dans l’ici et maintenant avec une curiosité ouverte. La pleine conscience (mindfulness) est l’outil central de ce processus, permettant de sortir du pilote automatique et de s’engager pleinement dans sa vie.
- Le Soi Observateur : Accéder à une partie de notre conscience qui observe nos expériences (pensées, émotions, souvenirs) sans s’y identifier. C’est un point de vue stable à partir duquel on peut constater que nous ne sommes pas nos pensées.
- Les Valeurs : Clarifier ce qui est profondément important pour soi. Les valeurs ne sont pas des objectifs à atteindre, mais des directions qui guident nos actions et donnent un sens à notre existence (ex. être bienveillant, créatif, courageux).
- L’Action Engagée : Poser des actes concrets, jour après jour, qui sont guidés par nos valeurs. C’est par l’action que l’on construit une vie qui en vaut la peine, même face aux obstacles internes et externes.
-
Le message principal du Piège du Bonheur est libérateur : il n’est pas nécessaire d’attendre que la souffrance disparaisse pour commencer à vivre. En cessant la lutte contre notre propre expérience et en nous engageant dans des actions qui comptent pour nous, nous pouvons nous échapper du piège et cultiver une vie pleine de vitalité, de sens et d’épanouissement authentique…
HARRIS Russ, Le piège du bonheur est paru chez Pocket > Pocket Evolution en 2017 (rééd.), dans une traduction de Louise Chrétien.
UK > FR
EAN 9782266269230
384 pages
Disponible en poche.
Ce que nous en disons…
Encore du développement personnel, me direz-vous. Oui, vous répondrai-je, mais avec un truc en pluche (comme disait Zizi Jeanmaire quand elle oubliait son dentier). L’approche ACT est pleine de fraîcheur, en ceci qu’elle vise à s’entraîner à ne pas prendre chacune de nos pensées pour argent comptant. A écouter Harris, le principe est de s’asseoir paisiblement devant le paysage de notre existence sans commencer à ouvrir son parapluie parce qu’il y a des nuages à l’horizon : un parapluie, ça ne sert que quand il pleut ! Ma métaphore n’est pas terrible mais elle peut aider à saisir le propos de Harris : toutes nos pensées ne sont pas utiles à notre survie et il nous revient de les objectiver afin de ne consacrer de l’énergie qu’à celles qui le sont. Raison garder, donc…
Il y a par contre un point dont j’aimerais discuter avec Harris, un soir d’Angleterre, au fond d’un pub. Si j’ai bien compris, la thérapie ACT qu’il préconise et illustre avec force exemples (ce qui rend le livre très lisible) vise à libérer la pensée pour laisser la place à l’expérience directe. Son calcul est simple : ne vous occupez pas de vos pensées inutiles, cela vous permettra de vivre l’expérience directe de manière satisfaisante, c’est à dire en fonction de vos valeurs authentiques. Et de citer : la famille, la lutte contre le réchauffement climatique, la justice sociale… Or – et c’est une conviction personnelle – ces valeurs me semblent appartenir à des discours très extérieurs au sujet pensant. J’aurais plutôt conclu que la satisfaction de vivre l’expérience directe naissait de la pertinence de nos actions dans la situation donnée (je suis à ma place, en sécurité, parce que je fais ce qu’il faut faire maintenant). Quelque chose comme le ‘vivre à propos‘ de Montaigne.
Certes, l’ouvrage est destiné à ceux qui en ont besoin et je comprendrais qu’il agace les professionnels comme les amateurs éclairés : beaucoup de notions sont simplement effleurées ; on ne trouve nulle part de définition du « je » qui est censé faire le tri entre pensées opérationnelles et pensées contre-productives ; l’esprit, la conscience, le Soi, la raison et toutes ces sortes de choses surnagent dans le bouillon ; la forme même du livre invite aux exercices quotidiens – tant mieux pour la famille-tout-le-monde – mais éclaire peu sur le fond. De là à penser que le Dr Harris pousse indirectement à suivre son module ACT en huit semaines (disponible en anglais sur son site), il n’y a qu’un pas.
Soit, faire la part des choses dans ses pensées (« Je ne suis pas tout ce que je pense« ) invite par contre à ne pas jeter le bébé avec l’eau du bain : la méthode donne à réfléchir et est réputée efficace, ailleurs que sur les réseaux sociaux. Si on creuse bien, elle préconise un mode de pensée qu’il s’apparente au travail de raison et, parallèlement, les exercices proposés visent clairement à restaurer ce que, souvent, nous négligeons dans nos délibérations : l’expérience directe. Qui plus est la terminologie propre à la méthode ACT est bien expliquée et les entraînements permettront à plus d’un de libérer sa pensée des aveuglements affectifs. En termes de développement personnel, on parlera pas d’une publication de haut vol mais, de temps en temps, une bonne potée, ça fait du bien !
Bonnes feuilles…
Comment notre esprit exacerbe notre inconfort émotionnel
Les jugements constituent pour notre esprit une des façons courantes d’exacerber notre inconfort émotion-nel, mais il y en a de nombreuses autres. Vous trouverez ci-après une liste de questions fréquentes que l’esprit pose ou commente et qui ont souvent pour effet de remuer ou d’intensifier des émotions désagréables.
« Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? »
Cette question vous amène à passer en revue tous vos problèmes, un à un, pour voir si vous pouvez cerner la cause de vos émotions. Naturellement, cet exercice ne sert qu’à empirer la situation, car il vous donne l’illusion que votre vie n’est qu’une série de problèmes. Il vous amène aussi à passer beaucoup de temps à vous perdre dans vos pensées désagréables.
Ce processus vous est-il utile de quelque façon ? Vous aide-t-il à passer à l’action pour changer votre vie pour le mieux ?
En général, les gens se posent cette question en croyant que s’ils arrivent à expliquer pourquoi ils se sentent aussi mal dans leur peau, ils trouveront une façon de se sentir mieux. Malheureusement, cette stratégie se retourne presque toujours contre nous, comme nous l’avons vu précédemment. En outre, dans la plupart des cas, il importe peu de savoir pourquoi ces émotions désagréables ont surgi ; ce qui compte, c’est la façon dont vous y réagissez. Le principe fondamental est toujours le suivant : ce que vous ressentez est ce que vous ressentez ! Par conséquent, si vous pouvez apprendre à accepter vos émotions sans avoir à les analyser, vous vous épargnerez beaucoup de temps et d’efforts.
« Qu’ai-je fait pour mériter ça ? »
Cette question vous amène à vous blâmer. Vous ressassez tout ce que vous avez pu faire de mal afin de comprendre pourquoi l’univers tout entier a décidé de vous punir. Ainsi, vous finissez par vous dévaloriser, par vous sentir inutile, mauvais ou inadéquat.
Encore une fois, cela vous est-il utile de quelque manière ? N’est-ce pas simplement une autre stratégie de contrôle inefficace ?
« Pourquoi suis-je toujours comme ça ? »
Cette question vous amène à fouiller votre vie entière pour trouver des raisons qui expliquent votre façon d’être. Très souvent, cela fait surgir des émotions de colère, de ressentiment et d’impuissance. Et vous finissez généralement par blâmer vos parents.
Est-ce que cela vous est utile ?
J’en suis incapable !
Les variations sur ce thème incluent : « C’est intenable ! », « Je n’y arriverai pas » ou « Je vais faire une dépression nerveuse !« , et ainsi de suite. Fondamentalement, votre esprit veut vous convaincre que vous êtes trop faible pour faire face à la situation et que le. choses tourneront mal si vous continuez à vous sentir ainsi.
Est-ce là un scénario qui peut vous être utile ?
« Je ne devrais pas me sentir comme ça ! »
La phrase classique. Ici, votre esprit se dispute avec la réalité. Or, la réalité est la suivante : ce que vous ressentez dans l’instant présent est bien ce que vous ressentez, mais votre esprit vous dit : « La réalité a tort. Ce n’est pas censé être comme ça ! Arrêtez tout ! Donnez-moi la réalité que je veux ! » Ce genre de conflit avec la réalité ne se termine jamais en votre faveur.
Et est-ce que ça y change quelque chose?
« Je voudrais tellement ne pas me sentir comme ça ! »
Prendre ses désirs pour des réalités est l’un des passe-temps préférés de notre esprit : « Je voudrais tellement être plus sûr de moi ! » ou « J’aimerais tellement être moins anxieuse ! » Ces rêves éveillés peuvent nous occuper pendant des heures ; nous nous imaginons que notre vie serait tellement plus agréable si seulement nos émotions étaient différentes.
Est-ce que cela nous aide à composer avec notre vie telle qu’elle est maintenant ?
Cette liste de questions pourrait être interminable. Contentons-nous de dire que le moi pensant dispose d’innombrables moyens pour intensifier directement nos émotions désagréables ou nous faire perdre un temps fou à les ressasser. Par conséquent, dorénavant, chaque fois que vous constaterez que les pensées et les commentaires de votre esprit vous accrochent, refusez simplement de jouer le jeu. Remerciez votre esprit d’essayer de vous faire perdre du temps et concentrez-vous plutôt sur des activités plus utiles ou plus importantes. Vous jugerez peut-être utile de vous dire : « Merci, cher esprit, mais je ne joue pas aujourd’hui ! »
33. Une vie qui a du sens
Nous voici au dernier chapitre. Il est à espérer qu’à ce stade, votre souplesse psychologique s’est améliorée et que vous avez déjà généré une vie riche et pleine de sens. Si tout va bien, continuez sur votre lancée ; continuez à faire ce qui vous donne des résultats. Si rien ne va, vous devez en chercher les raisons et voir ce que vous pouvez faire. Cependant, avant d’aller plus loin, revoyons ensemble les six principes fondamentaux de la thérapie ACT :
-
-
- La DEFUSION. Reconnaître ses pensées, ses images et ses souvenirs pour ce qu’ils sont – simplement des mots et des représentations mentales – et les laisser aller et venir naturellement, sans les combattre, sans chercher à les fuir et sans leur accorder plus d’attention qu’ils n’en méritent.
- L’EXPANSION. Faire de la place à ses émotions, à ses sensations et à ses impulsions, et les laisser aller et venir sans les combattre, sans les fuir et sans leur accorder une attention indue.
- La CONNEXION. Utiliser sa pleine conscience pour vivre le moment présent avec ouverture, intérêt et réceptivité ; centrer son attention sur ce que l’on fait et s’y investir pleinement.
- Le MOI OBSERVATEUR. Prendre conscience de cette partie transcendante de soi-même ; un point de vue à partir duquel on peul observer ses émotions et ses pensées difficiles, sans les laisser nous faire du mal. C’est la partie de soi qui est constante, toujours présente et imperméable aux préjudices. Elle n’a pas de propriétés physiques ; elle est « pure conscience. »
- Les VALEURS. Clarifier ce qui compte le plus pour soi ; déterminer quel genre de personne on veut être, ce qui compte pour soi, ce qui a de la valeur à nos yeux et ce qu’on veut défendre dans la vie.
- L’ACTION ENGAGÉE. Passer à l’action d’une manière conforme à ses valeurs (encore et encore, peu importe le nombre de fois que l’on s’est égaré)…
-
L’auteur…
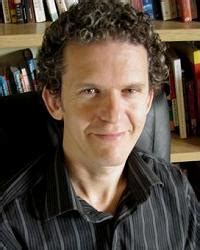 [LISEZ.COM] « Médecin, psychothérapeute, coach de vie et conférencier spécialisé dans la gestion du stress, Russ Harris a aidé des milliers des personnes dans le monde à maîtriser leur peur et à acquérir une véritable confiance en soi, grâce aux techniques de la thérapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Il est également l’auteur de L’Amour engagé (2010), du Grand Saut (2011) et du Choc de la Réalité (2013), parus aux Éditions de l’Homme. »
[LISEZ.COM] « Médecin, psychothérapeute, coach de vie et conférencier spécialisé dans la gestion du stress, Russ Harris a aidé des milliers des personnes dans le monde à maîtriser leur peur et à acquérir une véritable confiance en soi, grâce aux techniques de la thérapie ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Il est également l’auteur de L’Amour engagé (2010), du Grand Saut (2011) et du Choc de la Réalité (2013), parus aux Éditions de l’Homme. »
[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : librel.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, © thehappinesstrap.com.
Lire encore en Wallonie-Bruxelles…


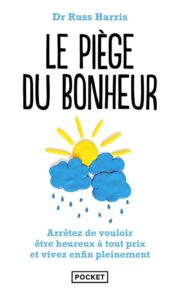

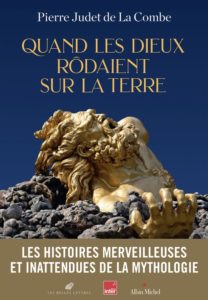
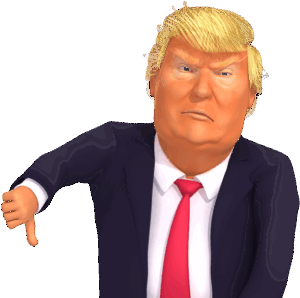

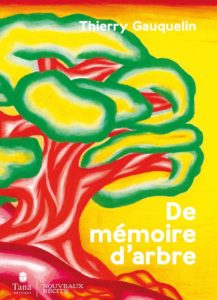


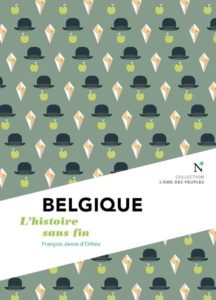
 Journaliste spécialisé dans l’actualité internationale, notamment pour Le Vif L’Express, François Janne d’Othée a toujours gardé Bruxelles comme port d’attache. Il en connaît autant ses angles attachants que ses recoins moins glamour, et souvent romanesques.
Journaliste spécialisé dans l’actualité internationale, notamment pour Le Vif L’Express, François Janne d’Othée a toujours gardé Bruxelles comme port d’attache. Il en connaît autant ses angles attachants que ses recoins moins glamour, et souvent romanesques.