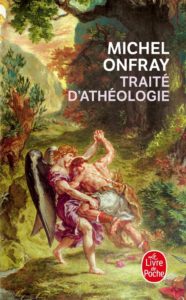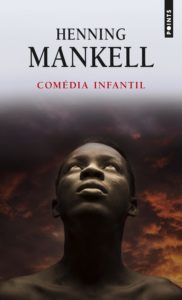Ce qu’ils en disent…
La lettre érotique de Jana Černá à Egon Bondy, une métaphore du féminisme…
[FRANCAIS.RADIO.CZ, 8 août 2020] Pas dans le cul aujourd’hui : derrière ce titre provocateur, extrait d’un poème de l’écrivaine tchèque Jana Černá, se cache une lettre d’amour passionnée et sans retenue qu’elle a écrite à son amant Egon Bondy au début des années 1960, et publiée en français en 2014 aux éditions La Contre Allée. Dans ce texte d’une centaine de pages, la fille de Milena Jesenská clame son désir à l’homme qu’elle aime, entremêlant considérations philosophiques et descriptions crues de ses fantasmes. Rebelle à tout conformisme, Jana Černá y affirme sa liberté totale de femme désirante et son refus de dissocier le corps et l’intellect. Pour évoquer ce texte, Radio Prague Int. a interrogé l’éditrice du texte, Anna Rizzello, qui a rappelé comment elle l’avait découvert.
Anna Rizzello : “J’ai découvert la lettre il y a très longtemps, une vingtaine d’année environ, en Italie. J’ai vu ce texte dans une librairie de Turin. C’était donc une traduction italienne. Ce n’était pas tout à fait le même texte que nous avons publié, mais c’était le même titre. Dans cette traduction italienne, il y avait ce texte et plusieurs de ses poèmes que nous n’avons pas reproduits dans notre édition.
Et l’envie est venue un jour de publier ce texte en français…
A.R. Entre les deux, j’ai déménagé en France. Ce texte m’a suivi, il était toujours dans ma bibliothèque. En 2013, j’ai organisé avec une amie un festival de littérature, appelé Littérature etc. C’était la première édition dont le thème était l’amour. En réfléchissant à des textes qui pourraient intégrer cette programmation. J’ai parlé de ce texte que nous avons traduit à deux, en faisant quelque chose d’un peu bâtard, pas forcément final. Cette traduction devait servir pour une lecture dans le cadre du festival. Je travaillais déjà aux éditions de la Contre-Allée, et la maison a bien voulu le publier. On a confié la traduction à Barbora Faure. Il y a donc eu plusieurs phases qui se sont terminées par la publication de la lettre un an après le festival, en 2014.
Il faut expliquer en quelques mots de quoi il s’agit. C’est une lettre d’amour très érotique, sans concessions, et en même temps qui est traversée de réflexions philosophiques. Tout est entremêlé. Pourriez-vous nous en dire plus ?
A.R. Effectivement ce qui est frappant, toujours aujourd’hui, et unique dans ce texte et dans le ton, c’est cet entrelacs de différentes choses. Il y a les aspects plus personnels, très émotifs. C’est une lettre d’amour que Jana Černá écrit à son amant en 1962. Ce n’était pas un texte destiné à la publication alors que par ailleurs elle était écrivaine. Ce texte était véritablement une lettre personnelle, intime. Elle est chez elle, le soir, elle ne savait pas forcément, en commençant à écrire, où cela la mènerait. Finalement, dans cette lettre, on croise tout : ce qu’est, pour elle, la relation amoureuse qui doit comprendre aussi bien un lien très fort au niveau intellectuel et sexuel. Tout ce qu’elle entend par poésie, philosophie et littérature est quelque chose de très concret en fait. C’est ce qui est beau, selon moi : c’est quelque chose qui, pour elle, est très lié au quotidien. La philosophie et la poésie ne vivent pas dans les bibliothèques ni les livres. Elles vivent dans la rue, dans les conversations avec les gens et dans la réalité. Je trouve cela très fort, d’autant plus que Jana Černá incarnait cela dans sa vie.
Ce n’est donc pas seulement un texte théorique, mais totalement incarné par elle. C’est pour cette raison que la lettre est si singulière aussi. C’était quelqu’un d’exceptionnel qui a eu une vie incroyable : elle a fait pleins de métiers différents, femme de ménage, poinçonneuse, elle a eu plusieurs enfants qui lui ont été enlevés parce qu’elle ne pouvait pas s’en occuper. C’était la fille de Milena Jesenská donc elle vient d’un milieu familial où plusieurs cultures se mêlaient. Elle ne sort pas de nulle part non plus. Dans sa lettre, elle développe quelque chose que l’on peut qualifier de philosophique même s’il n’y a rien de systématique ou de dogmatique. Le texte a été écrit en 1962 mais il me semble qu’il n’a pas pris une ride, que ce soit au niveau du vocabulaire que des thématiques. Cela reste encore tabou de dire des choses comme celles-ci et de cette façon.
Il faut en effet rappeler que Jana Černá est la fille de Milena Jesenská, mondialement connue pour avoir correspondu avec Franz Kafka, même si elle n’est pas du tout réductible à cette correspondance. C’est une journaliste, une grande figure de l’antinazisme dans la Tchécoslovaquie de l’entre-deux-guerres, elle a été résistante et a fini sa vie à Ravensbrück en 1944. Peut-on dire que cette sorte d’esprit rebelle de Jana Černá est un héritage de sa mère ?
A.R. Oui. D’ailleurs Jana Černá a écrit un livre magnifique sur sa mère, Vie de Milena, que nous avons également publié. Là aussi, il s’agit d’une biographie pas du tout conformiste dans le ton. Elle relate pleins de faits qui finalement donnent une profondeur et une richesse à la vie de sa mère. Elle s’inscrit aussi dans cette tradition-là de la rébellion, de l’anticonformisme et de la justice. Ce n’était pas de l’anticonformisme juste pour être anticonformiste. C’était quelque chose qui a à voir avec cette idée de justice très forte et très ancrée en Milena. Elle en est d’ailleurs morte et cette idée est clairement inscrite dans sa fille.
Dans l’introduction du livre, vous dites que cette lettre est une métaphore du féminisme. En quoi ?
A.R. C’est quelque chose que je pense personnellement. Je ne suis pas sûre que Jana Černá se serait reconnue dans cette affirmation. Je ne veux pas parler à sa place. Il s’agit de ma lecture. Mais pour tout ce que nous venons d’évoquer, oui, je pense qu’il y a quelque chose qui préfigure le féminisme, bien avant 1968, à travers cette liberté de ton vis-à-vis de la sexualité, de la façon dont elle l’envisage et dont elle vit au quotidien. Pour elle, il n’y a pas de hiérarchie dans le couple, elle assume pleinement son désir, sa sexualité et la façon dont elle veut la vivre. C’est extrêmement novateur pour l’époque cette affirmation du désir féminin. Effectivement, c’est un prélude aux revendications qui seront sur le devant de la scène en 1968 et dans les années 1970 avec le mouvement féministe.
Et peut-être même par rapport à notre période actuelle. La lettre est sortie en français en 2014. Aujourd’hui, le féminisme connaît, sous diverses formes, un véritable regain. Le texte est aussi en résonnance avec des affirmations féministes actuelles…
A.R. Absolument. C’est pour cela que ce texte continue d’être lu, six ans après sa publication. Il continue à circuler. Nous recevons encore beaucoup d’échos de libraires, de lecteurs… Il résonne très fort avec le contexte actuel. Les choses évoluent, mais il y a aussi des retours en arrière par rapport au désir féminin, au consentement, et à toutes ces questions. Ce texte-là n’est pas une réponse, mais plutôt quelque chose qui peut toujours nous éclairer. C’est ainsi qu’on devrait vivre sa propre sexualité et c’est ainsi qu’elle devrait aussi être perçue du point de vue masculin. C’est aussi cela qui est intéressant : c’est une femme qui écrit, mais elle s’adresse à un homme. D’ailleurs, en France, on a reçu beaucoup d’échos de la part d’hommes, ce qui est rare pour un texte de ce type. Souvent, ce sont des femmes qui s’expriment, mais là, c’était aussi beaucoup les hommes. Je pense que ça fait du bien aux hommes aussi de lire un texte comme celui-ci !
Rappelons dans quel contexte la lettre est écrite. On est dans les années soixante. On est avant la libéralisation du Printemps de Prague qui est un peu plus tardive, mais il y a ces cercles underground autour de son amant Egon Bondy et d’autres écrivains tchèques. Il y a tout de même un vrai bouillonnement intellectuel et artistique à cette époque-là…
A.R. Tout à fait. Bohumil Hrabal faisait également partie du cercle de ses amis. Jana Černá s’inscrivait vraiment dans cette avant-garde, avant le Printemps de Prague. Elle écrivait, mais il y avait deux types d’écriture chez elle : les livres qui passaient la censure, qu’elle publiait sous nom et dont elle n’était pas très fière, et il y avait les vrais textes littéraires qui étaient publiés en samizdat, lus par ses amis, par Bondy, Hrabal et les autres. Elle à la fois vécu et contribué à cette effervescence de l’époque.
Dans ce texte, le langage est extrêmement cru, mais pas une seconde on a l’impression que c’est vulgaire. Un vrai tour de force !
A.R. Oui, c’est vrai. C’est ce que j’ai ressenti, de même que tous les lecteurs et les lectrices. Ce n’est pas vulgaire du tout. Ce n’est pas seulement le fait qu’elle soit une grande écrivaine, mais c’est aussi une question de sensualité, de sentiments. Ce qu’elle exprime dans cette lettre est totalement sincère, elle ne cherche pas à choquer. Elle ne fait pas de la provocation facile, elle dit les choses comme elle les pense. Ce n’est jamais vulgaire parce que c’est juste l’expression de quelque chose de très profond qui ne cherche pas à choquer, et a fortiori pas Egon Bondy ! Il en a certainement vu d’autres… Il faut garde cela en tête aussi. C’est un écrit intime pour quelqu’un qui la connaît. Dès lors, cette sensualité-là passe sans problème. »
Anna Kubišta
Ce qu’ils en disent…
[RTBF.BE, 30 septembre 2014] Tiré d’un poème de l’auteure, le titre souligne à la fois la charge érotique du texte et la rébellion extraordinaire d’une femme face à l’ambiance étouffante en Tchécoslovaquie d’après-guerre. Probablement écrite en 1962, cette lettre est un véritable manifeste pour la liberté individuelle.
Dans les années qui précèdent le Printemps de Prague, Jana Černá livrait dans cette lettre à Egon Bondy sa volonté de révolutionner les codes de conduite, de rechercher de nouveaux possibles dans la vie privée, les rapports sentimentaux et la sexualité. En refusant de se soumettre à la primauté masculine, elle affirme aussi son souhait d’une sexualité non séparée des sentiments et de l’activité intellectuelle.
Dotée d’une personnalité hors du commun, Jana Černá fascinait son entourage par sa vitalité et son audace. Plusieurs fois mariée et mère de 5 enfants, elle n’a exercé que des emplois occasionnels tels que femme de ménage, contrôleuse de tramway etc. Marginalité et rejet de tout conformisme social, langagier ou politique semblent avoir été ses maîtres mots. Cette lettre débarrassée de toutes conventions, au ton libre et spontané, est d’une étonnante modernité.
Jana Černá fréquente Egon Bondy, auteur mythique en Tchéquie, spécialiste des philosophies orientales, mais aussi auteur des textes des Plastic People of the Universe, le groupe de rock symbole de la rébellion des années 70. Tous deux font partie de la culture clandestine de Prague avec Bohumil Hrabal, l’un des plus importants écrivains tchèques de la seconde moitié du XXe siècle. Ils ont publié leurs écrits sous forme de ‘Samizdat’ (système de circulation clandestine d’écrits dissidents en URSS et dans les pays du bloc de l’Est) jusqu’à la chute du communisme. Jana Černá collaborera à différentes publications de cette mouvance, sous divers pseudonymes (Gala Mallarmé, Sarah Silberstein) ainsi que sous son nom de Jana Krejcarova.
Myriam Leroy

ČERNÁ Jana, Pas dans le cul aujourd’hui a probablement été rédigé en 1962 et est paru chez La Contre Allée en 2014, dans une traduction de Barbora Faure.
CZ > FR
EAN 9782917817278
96 pages
Disponible en ePub et poche.
Ce que nous en disons…
Une parole libre, salutaire en ces temps de puritanisme qui rongent nos horizons…
Bonnes feuilles…
S’ il existe un espoir concret que tu produises un fruit mûr alors c’est seulement à condition que ce fruit te comprenne tout entier, avec tes chaussettes, ton horreur des bibliothèques, ta barbe, ta bière, ta fantaisie, ton intellect, ta queue, tout ce qui se rapporte à toi.
L’auteure…
 [infos éditeur] Jana Černá (Honza, “Jeannot”, pour sa mère) est née à Prague en 1928, fille de l’architecte avant-gardiste J. Krejcar et de Milena Jesenská (la célèbre Milena de Kafka, journaliste et résistante, emprisonnée en août 1939 et morte à Ravensbrück). Confiée à son grand-père, Jana a suivi des études secondaires, puis artistiques. Elle a très vite choisi la vie de bohème et n’a jamais exercé d’emploi stable, exerçant des activités occasionnelles telles que femme de ménage, contrôleuse de tramway, aide-cuisinière. A la mort de son grand-père en 1947 elle s’est trouvée à la tête d’un vaste héritage qu’elle n’a pas tardé à dilapider. Plusieurs fois mariée et mère de 5 enfants, elle a fréquenté les milieux littéraires de la mouvance surréaliste et underground et collaboré à différentes publications de cette mouvance, sous divers pseudonymes (Gala Mallarmé, Sarah Silberstein) ainsi que sous son nom de Jana Krejcarova. Marginalité et rejet de tout conformisme social, langagier ou politique semblent avoir été ses maîtres mots. Vers la fin de sa vie elle se consacre à la création de céramiques. Elle meurt en 1981 dans un accident de la circulation. Le philosophe Egon Bondy, dans la vie de qui elle est restée profondément ancrée, a écrit le jour de son enterrement : “On l’enterre en ce moment et moi je suis si loin, assis dans une ville glacée où personne ne sait qu’elle a été ce que l’homme peut atteindre de plus grand.”
[infos éditeur] Jana Černá (Honza, “Jeannot”, pour sa mère) est née à Prague en 1928, fille de l’architecte avant-gardiste J. Krejcar et de Milena Jesenská (la célèbre Milena de Kafka, journaliste et résistante, emprisonnée en août 1939 et morte à Ravensbrück). Confiée à son grand-père, Jana a suivi des études secondaires, puis artistiques. Elle a très vite choisi la vie de bohème et n’a jamais exercé d’emploi stable, exerçant des activités occasionnelles telles que femme de ménage, contrôleuse de tramway, aide-cuisinière. A la mort de son grand-père en 1947 elle s’est trouvée à la tête d’un vaste héritage qu’elle n’a pas tardé à dilapider. Plusieurs fois mariée et mère de 5 enfants, elle a fréquenté les milieux littéraires de la mouvance surréaliste et underground et collaboré à différentes publications de cette mouvance, sous divers pseudonymes (Gala Mallarmé, Sarah Silberstein) ainsi que sous son nom de Jana Krejcarova. Marginalité et rejet de tout conformisme social, langagier ou politique semblent avoir été ses maîtres mots. Vers la fin de sa vie elle se consacre à la création de céramiques. Elle meurt en 1981 dans un accident de la circulation. Le philosophe Egon Bondy, dans la vie de qui elle est restée profondément ancrée, a écrit le jour de son enterrement : “On l’enterre en ce moment et moi je suis si loin, assis dans une ville glacée où personne ne sait qu’elle a été ce que l’homme peut atteindre de plus grand.”
[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : francais.radio.cz ; rtbf.be ; librel.be | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : en-tête, Jana Černá et Egon Bondy dans les rues de l’époque (1950-60) © DP.
Lire encore en Wallonie-Bruxelles…
- RINGELHEIM : La seconde vie d’Abram Potz (2005)
- QUAGHEBEUR : Anthologie de la littérature française de Belgique ; entre réel et surréel (2006)
- HUNYADI : Faire confiance à la confiance (2023)
- DESPRET : Au bonheur des morts (2015)
- JANNE d’OTHEE : Belgique. L’histoire sans fin (2024)
- TOLKIEN : Le Seigneur des anneaux (3 tomes, 1954-1955)
- OLIVER : Une Ourse dans le jardin (non-publié, 2024)







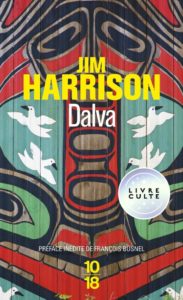


 Journaliste spécialisé dans l’actualité internationale, notamment pour Le Vif L’Express, François Janne d’Othée a toujours gardé Bruxelles comme port d’attache. Il en connaît autant ses angles attachants que ses recoins moins glamour, et souvent romanesques.
Journaliste spécialisé dans l’actualité internationale, notamment pour Le Vif L’Express, François Janne d’Othée a toujours gardé Bruxelles comme port d’attache. Il en connaît autant ses angles attachants que ses recoins moins glamour, et souvent romanesques.