Ce qu’ils en disent…
[PUF.COM] La situation est inédite. Jamais, dans l’histoire de l’humanité, nous n’avons disposé d’autant d’informations et jamais nous n’avons eu autant de temps libre pour y puiser loisir et connaissance du monde. Nos prédécesseurs en avaient rêvé : la science et la technologie libéreraient l’humanité. Mais ce rêve risque désormais de tourner au cauchemar. Le déferlement d’informations a entraîné une concurrence généralisée de toutes les idées, une dérégulation du « marché cognitif » qui a une fâcheuse conséquence : capter, souvent pour le pire, le précieux trésor de notre attention. Nos esprits subissent l’envoûtement des écrans et s’abandonnent aux mille visages de la déraison. Victime d’un pillage en règle, notre esprit est au cœur d’un enjeu dont dépend notre avenir. Ce contexte inquiétant dévoile certaines des aspirations profondes de l’humanité. L’heure de la confrontation avec notre propre nature aurait-elle sonné ? De la façon dont nous réagirons dépendront les possibilités d’échapper à ce qu’il faut bien appeler une menace civilisationnelle. C’est le récit de cet enjeu historique que propose le nouveau livre événement de Gérald Bronner.
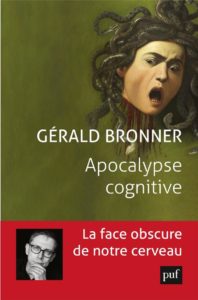
BRONNER Gérald, Apocalypse cognitive est paru aux Presses Universitaires de France (PUF) en 2021.
FR
EAN 9782130733041
372 pages
Disponible en grand format, ePub et audio.
Ce que nous en disons…
Incontournable…
Bonnes feuilles…
En novembre 1989, le mur de Berlin tombait. Encore un peu jeune pour comprendre pleinement la portée d’un tel événement, je voyais bien qu’il s’agissait de quelque chose de joyeux : les gens acclamaient, dansaient. Cette même année, les sinistres Ceausescu tombaient, eux aussi. En un mot, la grande histoire s’invitait à notre table par l’entremise du déclin de l’Empire soviétique et c’était une chance d’être témoin de cela. En même temps, il y avait ce sentiment mélancolique car un tel événement ne se reproduirait plus, affirmaient certains. C’était le cas de Francis Fukuyama qui, à trente ans à peine, publiait un livre qui allait être commenté partout sur la planète : La Fin de l’histoire et le dernier homme. Ce livre du jeune politologue, qui prolongeait un article paru en 1989 dans la revue The National Interest, fut considéré par certains comme l’un des essais les plus importants du second XXe siècle. On pouvait y lire que la chute de l’Empire communiste annonçait l’avènement du monopole de l’idéal de la démocratie libérale. Fukuyama savait bien que la violence et les troubles ne disparaîtraient pas pour autant mais du moins, pensait-il, aucun système de représentation idéologique ne serait en mesure de concurrencer la démocratie libérale, qui constituait désormais le seul horizon possible de la pensée politique.
Était-ce le caprice d’un enfant gâté ? Dans la pacification généralisée que l’on nous prophétisait, quelque chose ne me plaisait pas. Nous allions donc vivre sur le cours lent et ennuyeux de la vie ? Il faut ne pas avoir connu les horreurs de l’histoire pour raisonner de la sorte mais c’est ainsi que j’entamais la fin du siècle dernier. Je constatais aussi que l’indignation morale qui devenait permanente – déjà – servait de cache-misère à ma génération, pas moins courageuse que les autres mais qui ne trouverait plus d’occasion d’être véritablement héroïque. L’histoire allait-elle donc s’achever ? Il fallait vraiment que ma formation intellectuelle ait été imparfaite pour que j’aie pu croire en de pareilles fables. L’histoire ne s’arrête jamais.
Trois décennies plus tard, il apparaît que l’histoire galope dans notre présent. Elle va si vite qu’il est presque impossible de la penser bien. Les systèmes politiques qui se proposent comme voie de substitution au modèle des démocraties libérales ne manquent pas : société de marché autoritaire comme en Chine, démocrature comme en Turquie ou en Russie, islam politique ou encore changement de société proposé par l’arborescence de l’écologisme politique, dont certaines branches désirent la décroissance quand d’autres se déclarent de l’antispécisme.
D’entre tous les faits qui caractérisent cette période passionnante et inquiétante, je retiens que les vingt premières années du XXIe siècle ont instauré une dérégulation massive d’un marché cognitif que l’on peut également appeler le marché des idées. Celle-ci se laisse appréhender, d’une part, par la masse cyclopéenne et inédite dans l’histoire de l’humanité des informations disponibles et, d’autre part, par le fait que chacun peut verser sa propre représentation du monde dans cet océan. Cette situation a affaibli le rôle des gate keepers traditionnels (journalistes, experts académiques… toute personne considérée comme légitime socialement à participer au débat public) qui exerçaient une fonction de régulation sur ce marché. Ce fait sociologique majeur a toutes sortes de conséquences mais la plus évidente est que l’on assiste à une concurrence généralisée de tous les modèles intellectuels (des plus frustes au plus sophistiqués) qui prétendent décrire le monde. Aujourd’hui, quelqu’un qui détient un compte sur un réseau social peut directement apporter la contradiction, sur la question des vaccins par exemple, à un professeur de l’Académie nationale de médecine. Le premier peut même se targuer d’une audience plus nombreuse que le second.
Ce n’est pas la première fois dans l’histoire que croyance et pensée méthodique entrent en concurrence, même si, souvent, la première a pu à proprement parler interdire à la seconde de s’exprimer. Dans certaines sociétés, le coût pour les contrevenants qui désiraient défendre la science naissante et la pensée méthodique pouvait être la mort. La croyance peut donc interdire à la connaissance de faire valoir ses arguments, par la menace du bûcher par exemple. Pourtant, elle cherche le plus souvent des aménagements pour éviter la confrontation directe des arguments qui lui seraient défavorables. Ainsi, au temps de la scolastique, lorsqu’on s’interrogeait sur les liens entre Dieu et la nature, les penseurs de l’époque se trouvaient tiraillés entre la foi et la raison. C’est dans un XIIIe siècle traversé de crises universitaires que l’on invente cette double vérité que l’historien Alain de Libera nomme la « schizophrénie médiévale », qui veut que le même individu puisse croire une chose comme philosophe et une autre comme chrétien1. C’est l’un des expédients que l’histoire des hommes a inventés pour éviter la confrontation. Mais cela n’a duré qu’un temps, et les progrès de la connaissance sont souvent entrés en concurrence directe avec la littéralité des textes religieux ou toute autre proposition relevant du surnaturel, de la magie et des pseudo-sciences.
Pour n’en prendre qu’un exemple, la vision que propose la Bible (Genèse 1, 20-30 et 2, 7) lorsqu’elle affirme que les animaux et l’homme ont été créés par Dieu – et chaque espèce séparément des autres – a perdu beaucoup de son prestige. Lorsqu’elle prétend encore que notre Terre a été créée en six jours (Genèse 1, 1-31) et qu’elle serait vieille de 6 000 ans, elle ne s’en tire pas mieux face à la découverte des fossiles, leur datation et, en général, les progrès de la connaissance, notamment au XIXe siècle. Tout cela a rendu très incommode la vision biblique du monde qui avait prévalu pendant des centaines d’années, et l’on peut dire que les modèles intellectuels proposés par la science sont entrés en concurrence hostile avec ceux proposés par la religion concernant certaines conceptions du monde.
Face à ce type de contradiction, le croyant a plusieurs options : soit abandonner sa croyance et admettre que le livre sur lequel il fonde sa foi est constitué de fables ; soit considérer que c’est la théorie de Darwin qui est fausse. Et cette seconde option est une solution plus courante que la première. Il est rare, en effet, qu’un croyant renonce à sa croyance sur la seule base d’une contradiction, aussi factuelle soit-elle. Il cherchera plutôt à discréditer ceux qui la portent, à disséquer à l’infini les méthodes qui ont abouti à ces conclusions qui le gênent, à débusquer les fautes dans les raisonnements qui y ont présidé. En bref, il ne se laissera pas faire et se battra jusqu’au bout pour préserver ce système de représentation qui l’aliène sans qu’il s’en rende compte.
C’est cette stratégie qui prévaut encore en Turquie, par exemple, où, en 2017, le Conseil de l’enseignement supérieur a décidé de retirer des manuels de biologie la théorie de Darwin, la jugeant contraire aux valeurs du pays. Désormais, seuls les plus de dix-huit ans sont autorisés à être initiés à ce qui constitue l’approche scientifique de l’énigme du vivant. La théorie de l’évolution est donc classée X, comme en Arabie saoudite. Aux États-Unis, la théorie de l’évolution n’est pas bannie des bancs de l’école mais elle rencontre peu d’audience. On peut, certes, se réjouir du fait que l’institut Gallup a souligné en 2019 que l’adhésion aux thèses de Darwin n’avait jamais été aussi forte dans ce pays mais on tempérera notre enthousiasme en constatant que seuls 22 % considèrent que « les êtres humains se sont développés sur des millions d’années à partir de formes de vie moins avancées, et que Dieu n’a rien à voir dans ce phénomène ». Ils n’étaient que 9 % en 1983, mais il reste que les tenants des thèses religieuses de la biologie demeurent – toutes sensibilités confondues – plus de 70 % aujourd’hui des habitants de la première puissance mondiale.
Une troisième stratégie est possible pour le croyant lorsque les progrès de la connaissance menacent ses représentations : considérer qu’il ne s’agit que d’une fausse opposition. Dès le XIXe siècle, on voit cette stratégie qui consiste à ménager la chèvre et le chou chez les croyants. Nombreux sont ceux parmi les catholiques proposant d’interpréter les jours bibliques comme la métaphore de périodes prolongées, d’époques géologiques. La Bible, pour eux, décrivait la très lente formation de l’univers et l’apparition successive des espèces, conformément à ce que la science venait de découvrir. Ils se sont alors extasiés devant la formidable modernité et le prophétisme scientifique du texte sacré2. La déclaration du pape Jean-Paul II à l’Académie pontificale des sciences le 22 octobre 1996 incite à penser que c’est une solution de ce type qui a la faveur du Vatican ; il y affirme notamment : « La théorie de l’évolution est plus qu’une hypothèse », et invite à un « dialogue confiant entre l’Église et la science »3. L’interprétation symbolique de textes qui prétendaient auparavant à la littéralité est une des ruses les plus habituelles de la croyance pour éviter la concurrence directe que lui imposent les arguments de la connaissance. Elle crée ainsi une plasticité qui rend la croyance irréfutable.
Mais alors, si les progrès de la connaissance perturbent de cette façon l’expression de la croyance, ne faut-il pas se réjouir de la concurrence cognitive généralisée qu’organise le monde contemporain ? En définitive, les énoncés objectivement rationnels ne vont-ils pas s’imposer à la faveur à cette libre concurrence contre les produits frelatés de l’esprit que sont les superstitions, les légendes urbaines et autres théories complotistes ?
Un regard même superficiel sur la situation actuelle va à rebours de cet espoir. Au contraire, cette libre concurrence favorise souvent les produits de la crédulité4. Certains phénomènes – qui par ailleurs n’ont pas attendu l’existence d’Internet pour se constituer en réalité sociale – ont été amplifiés depuis le début des années 2000. C’est le cas de la méfiance envers les vaccins, du conspirationnisme ou encore de la multiplication de toutes sortes d’alertes sanitaires ou environnementales pas toujours fondées en raison.
Même les platistes – qui défendent la théorie selon laquelle la Terre est plate – connaissent aujourd’hui une certaine audience puisqu’ils ont tenu leur premier congrès international en 2018. Ils aiment d’ailleurs à rappeler qu’ils ont « des membres tout autour du monde » [sic]. Comment expliquer l’incompréhensible résurgence d’une théorie aussi loufoque quand nous disposons de tant de clichés et d’expériences directes de la rotondité de la Terre ? En visionnant les vidéos – il y en a plus d’un million sur YouTube – défendant cette thèse et, par exemple, celles de Mark Sergant, l’un des leaders mondiaux de la communauté, nous constaterons que si tous les arguments sont réfutables, ils peuvent aisément troubler l’esprit qui n’y est pas préparé. Une telle croyance très marginale repose néanmoins cette lancinante question : pourquoi la libre concurrence sur le marché cognitif ne fait-elle tout simplement pas disparaître ce genre d’allégations ?
L’avantage concurrentiel dont bénéficient certaines propositions crédules est-il durable ou bien peut-on s’attendre à ce qu’à long terme, cette mise en concurrence des propositions intellectuelles favorise celles qui sont le mieux argumentées et les plus proches du canon de la rationalité ? Il est difficile de répondre autrement que de façon spéculative à cette question mais elle offre l’occasion de dialoguer avec un grand sociologue français disparu : Raymond Boudon. Ses lecteurs se souviennent qu’il a proposé dans la dernière partie de son œuvre une théorie progressiste des idées5. Il reconnaissait évidemment que les opinions collectives pouvaient s’égarer (il en fit l’un des sujets principaux de son œuvre) tout en affirmant, dans la lignée de Tocqueville, que, sur le temps long de l’histoire, ce sont les idées favorables au bien commun6 qui finissent par s’imposer. Le cœur de cette théorie « évolutionniste » vaut pour les idées relevant du vrai et du faux comme pour celles relevant du bien et du mal, et repose sur le concept de raisons qu’il nomme « transsubjectives » parce qu’elles ont « une capacité à être endossées par un ensemble de personnes, même si l’on ne peut parler à leur propos de validité objective ».
Cette notion aurait sans doute mérité un éclairage analytique plus puissant car elle conduit l’auteur à une proposition intellectuelle très forte : la transsubjectivité de certaines idées leur assure une forme de pérennité et une diffusion propice lorsque les conditions sociales le permettent, de sorte que, quand une idée de cette nature s’est imposée, les opinions publiques n’y reviennent plus. Selon lui, et il en défend le principe à maintes reprises, il y aurait un « cran de sécurité » rationnel dans le domaine du descriptif comme dans le domaine du normatif. L’exemple qu’il aimait à donner était celui de la peine de mort : une fois abolie, son principe n’est plus discuté. C’est donc bien une forme d’évolutionnisme optimiste qui caractérisait la façon dont Raymond Boudon concevait la sélection des idées et que l’on retrouve dans la dernière partie de son œuvre, aussi bien dans Le Sens des valeurs que dans son petit livre Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ?
La transsubjectivité d’une croyance se mesure donc à sa capacité à s’exporter vers d’autres esprits, du moins si l’on suppose qu’elles le font sur un marché cognitif où la concurrence entre les idées est pure et parfaite. C’est une situation que l’on ne retrouve pourtant guère dans la réalité. Les marchés cognitifs ont une histoire, et certaines idées bénéficient d’une position oligopolistique, voire monopolistique, non en raison de leur caractère transsubjectif, mais parce qu’elles profitent d’effets de diffusion qui assurent leur pérennité8. Cependant, peut-on vraiment faire le pari intellectuel qu’un marché libre des idées fera émerger les produits cognitifs les mieux argumentés du point de vue de la norme de la rationalité ?
On peut discuter cette hypothèse en invoquant précisément la notion de transsubjectivité, qui avait servi à Boudon à concevoir cette théorie évolutionniste. En effet, si elle permet de comprendre comment la concurrence cognitive offre sur le long temps de l’histoire de désincarcérer les jugements individuels de leurs déterminants subjectifs, elle recouvre aussi la possibilité pour certaines tentations inférentielles de converger sur un marché cognitif dérégulé pour donner un corps de vraisemblance à des idées fausses ou douteuses. La question est de savoir si la concurrence favorise toujours le meilleur produit ou seulement le plus satisfaisant. Sur bien des marchés, les deux sont parfois synonymes mais sur le marché cognitif, ils décrivent l’espace qui sépare la pensée méthodique de la crédulité. Et cette question est précisément celle que pose notre temps présent. C’est par elle que l’histoire fera puissamment valoir ses droits contre ceux qui ont pu imaginer qu’elle était terminée.
Car si les objets de contemplation mentale peuvent se multiplier et s’inscrire dans une concurrence effrénée, ce n’est pas seulement en raison des nouvelles conditions technologiques qui prévalent sur le marché de l’information, c’est aussi parce que la disponibilité de nos cerveaux est plus grande. Ces objets de contemplation n’ont d’autre raison d’être que de capter notre attention. Qu’ils proposent des théories sur le sens du monde, une doctrine morale, un programme politique ou même une fiction, ils ne peuvent survivre que si nous leur accordons une partie de notre temps de cerveau. Il se trouve, et c’est là un autre aspect significatif de l’histoire en train de se faire, que ce temps de cerveau disponible n’a jamais été aussi important.
La situation inédite dont nous sommes les témoins est donc celle de la rencontre de notre cerveau ancestral avec la concurrence généralisée des objets de contemplation mentale, associée à une libération inconnue jusqu’alors du temps de cerveau disponible.
Qui va l’emporter, dans cette lutte finale pour l’attention ? Il est là, l’enjeu des enjeux. Car dans ce temps de cerveau disponible, attendent des requiem fantastiques ou le remède contre le cancer tout autant que les pires crimes qu’on puisse concevoir ou les productions culturelles les plus navrantes. Ce temps de cerveau, nous pouvons aussi bien en user pour apprendre la physique quantique que pour regarder des vidéos de chats. Par conséquent, une question demeure, la plus politique de toutes les questions que nous pouvons poser car la réponse qu’on lui apportera déterminera l’avenir de l’humanité. Pas moins.
Ce temps de cerveau libéré, qu’allons-nous en faire ?
C’est cette question que ce livre propose d’explorer, en montrant notamment que la concurrence sur le marché cognitif permet de dévoiler certaines de nos aspirations profondes. En d’autres termes, la situation, parce qu’elle dévoile notre nature, permet d’approcher une anthropologie réaliste de notre espèce. D’entre toutes les civilisations intelligentes possibles, l’humanité fera-t-elle partie de celles qui peuvent surmonter leur destin évolutionnaire ? Tout dépendra de la façon dont nous gérerons ce temps de cerveau libéré, le plus précieux de tous les trésors du monde connu.
L’heure de la confrontation avec notre propre nature va sonner. Comme dans tous les récits initiatiques, le résultat de cette confrontation découlera de notre capacité à admettre ce que nous verrons dans le miroir. Certains se sont employés tout au long de l’histoire à nier l’existence de ce reflet en fomentant des projets de société fondés sur des anthropologies naïves et qui – comment pourrait-il en être autrement ? – se sont toujours mal terminés. Ils ont voulu faire advenir un homme nouveau, qui n’a pas répondu à l’appel. D’autres projets, au contraire, nous enjoignent à accepter ce reflet comme une fatalité, et ils font de nos intuitions les plus immédiates (ce qu’ils pourraient appeler le bon sens) et de nos appétits les plus impérieux une forme de légitimité politique. Ceux-là prennent souvent la forme du populisme et au moins celles, nombreuses, de la démagogie.
Il existe bien une autre voie, mais le chemin qui y mène est escarpé…
L’auteur…
[PUF.COM] Gérald Bronner (né en 1969) est professeur de sociologie à l’Université de Paris, membre de l’Académie des technologies et de l’Académie nationale de médecine. Il a publié plusieurs ouvrages couronnés par de nombreux prix. Son dernier ouvrage paru est Cabinet de curiosités sociales (collection « Quadrige », Puf, 2020).
[INFOS QUALITE] statut : validé| mode d’édition : partage, recension, correction et iconographie | sources : puf.com | contributeur : Patrick Thonart | crédits illustrations : © PUF.
Lire encore en Wallonie-Bruxelles…

